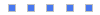


Ozu aime dépeindre son Japon où il est question de nostalgie, de souvenirs, et des grands moments passés ensemble lors d'une cérémonie du thé. Voyage à Tokyo, malgré sa longue durée, évoque ces thèmes avec sincérité et un recul nécessaire pour voir en Ozu les traces d'un "sage". On croirait voir en Chishu Ryu (formidable dans la peau d'un vieillard) l'image d'Ozu lui-même, délivrant tout son savoir faire et son expérience au service de "plus jeunes" débutant dans le cinéma. Ce qui est étonnant aussi c'est cette incroyable métamorphose de Chishu Ryu, que l'on voyait à peine cinq ans avant dans la peau d'un médecin quadragénaire alors en pleine forme. Il épaule à merveille sa partenaire, l'extraordinaire Igashiyawa Chieko bientôt prête à rendre l'âme. Le récit de Voyage à Tokyo est d'autant plus touchant puisqu'il traite avec brio les rapports humains, de gens de tout âge, en témoigne cette superbe séquence où Shukishi et Tomi discutent en face de la mer comme deux jeunes amoureux envahis de projets.
Voyage à Tokyo met aussi en avant le fait qu'il faut aimer chaque jour qui passe sous peine de le regretter plus tard. Ozu, en tant que bon humaniste et véritable artisan des sentiments donne alors toutes ses lettres de noblesses au genre avec le personnage de Noriko (Hara Setsuko) visiblement très touchée de ne pas avoir profité de chaque instant avec sa mère et de ne pas l'avoir traitée aussi bien qu'elle le pensait. Voyage à Tokyo n'est peut-être pas "le chef d'oeuvre d'Ozu" annoncé, mais contient une bonne partie de ce qui fait l'essence de son cinéma : sa mise en scène rigoureuse, ses cadres travaillés, on montage précis et son casting quatre étoiles. A noter la partition musicale, une nouvelle fois sublime.
 Si Voyage à Tokyo est un des films d’Ozu les plus connus et les plus emblématiques, c’est peut-être parce qu’il parvient le mieux à faire surgir, en filigrane des saynètes du quotidien plutôt banales et de dialogues souvent creux et polis, une signification qui touche à l’universel sur des thèmes aussi importants que la famille, la vieillesse et la mort, les séquelles de la guerre ou le temps qui passe. Sans prendre position et sans donner de leçons de morale, Ozu dépeint un gouffre générationnel devant lequel chacun pourra sans doute se reconnaître – et pas forcément en bien, ce qui en fait un film dérangeant sous ses aspects lisses. Sommes-nous en effet une partie de ce vieux couple habitant dans une petite bourgade de la région d’Hiroshima, coulant une petite retraite tranquille avec le regard tourné vers le passé, vers le souvenir de la guerre et de leur fils cadet tué au combat, et qui s’avèrent déçus de la place somme toute quelconque de leur fils, médecin de quartier qui habite une maison sans éclat – avant de se découvrir déconnectés du Japon moderne qui se développe à vitesse grand V ? Sommes-nous alors une partie de cette belle-fille coiffeuse qui expose sa vision intéressée des choses sans états d’âme, près de ses sous, et qui n’hésite pas à envoyer ses beaux-parents au vert pour économiser quelques yens et un peu de tranquillité, ou à réclamer le kimono de sa belle-mère trépassée ? Sommes-nous encore ces fils qui accordent tout leur temps à leur travail sans en consacrer à leurs parents, y compris lors des funérailles ? Ces petits-enfants insolents et indifférents ? Cette belle-fille souriante mais qui souffre d’être veuve si jeune ?
Si Voyage à Tokyo est un des films d’Ozu les plus connus et les plus emblématiques, c’est peut-être parce qu’il parvient le mieux à faire surgir, en filigrane des saynètes du quotidien plutôt banales et de dialogues souvent creux et polis, une signification qui touche à l’universel sur des thèmes aussi importants que la famille, la vieillesse et la mort, les séquelles de la guerre ou le temps qui passe. Sans prendre position et sans donner de leçons de morale, Ozu dépeint un gouffre générationnel devant lequel chacun pourra sans doute se reconnaître – et pas forcément en bien, ce qui en fait un film dérangeant sous ses aspects lisses. Sommes-nous en effet une partie de ce vieux couple habitant dans une petite bourgade de la région d’Hiroshima, coulant une petite retraite tranquille avec le regard tourné vers le passé, vers le souvenir de la guerre et de leur fils cadet tué au combat, et qui s’avèrent déçus de la place somme toute quelconque de leur fils, médecin de quartier qui habite une maison sans éclat – avant de se découvrir déconnectés du Japon moderne qui se développe à vitesse grand V ? Sommes-nous alors une partie de cette belle-fille coiffeuse qui expose sa vision intéressée des choses sans états d’âme, près de ses sous, et qui n’hésite pas à envoyer ses beaux-parents au vert pour économiser quelques yens et un peu de tranquillité, ou à réclamer le kimono de sa belle-mère trépassée ? Sommes-nous encore ces fils qui accordent tout leur temps à leur travail sans en consacrer à leurs parents, y compris lors des funérailles ? Ces petits-enfants insolents et indifférents ? Cette belle-fille souriante mais qui souffre d’être veuve si jeune ?
Avec une telle cohérence et de personnages, Ozu réussit le difficile pari de dire beaucoup avec peu de paroles et beaucoup de non-dits. Même si l’action est parfois un peu lente et s’étend sur plus de 2h15, la justesse du propos parviendra à toucher le spectateur qui aura su être patient et apprécier les sous-entendus, la symbolique des gestes, mots et regards de chacun. Un film riche et subtil sur la condition humaine.
 Une véritable histoire de famille qui pourrait arriver à tout le monde. Qui ne s'est pas réjouis de la visite de parents trop éloignés pour pouvoir avoir des contacts réguliers ? Et comme dans la plupart des cas, cette présence finit par gêner et la situation se dégrade peu à peu. Que doit-on penser d'une telle famille, où c'est finalement la belle-fille du fils décédé qui se dévoue le plus ? Tout le monde pense qu'il ferait un effort. Certes, mais avec le temps les idées changent vite…
Une véritable histoire de famille qui pourrait arriver à tout le monde. Qui ne s'est pas réjouis de la visite de parents trop éloignés pour pouvoir avoir des contacts réguliers ? Et comme dans la plupart des cas, cette présence finit par gêner et la situation se dégrade peu à peu. Que doit-on penser d'une telle famille, où c'est finalement la belle-fille du fils décédé qui se dévoue le plus ? Tout le monde pense qu'il ferait un effort. Certes, mais avec le temps les idées changent vite…
N'étant pas un cinéphile averti, je ne me permettrai pas de juger de la qualité artistique du film, mais plus de donner mon impression. Si l'histoire m'a bien plu, le film m'a paru tout de même un peu long. En revanche pour ce qui est de la réalisation et de la compréhension. Même en sous-titré, c'est difficile de ne pas comprendre quelque chose. Les décors, certes simples et épurés, sont toujours riches et symbolisent tous détails et messages à faire passer.
 Au rayon films panthéonisés auxquels j'aurai à faire de gros reproches sans pour autant que ça remette en cause leur statut, après le Faucon Maltais (1) et Quand la Ville Dort (1), voilà ce Voyage à Tokyo souvent cité parmi les sommets du cinéma mondial dans les sondages critiques ou de cinéastes. Parce qu'à mes yeux si le film a d'indéniables qualités il ne saurait soutenir la comparaison en termes d'accomplissement artistique dans un genre donné -le drame- (je conçois que ce ne soient pas des oeuvres directement comparables d'où cette remarque) avec Les Contrebandiers de Moonfleet, Rio Bravo ou Vertigo par exemple pour citer des habitués des référendums critiques. Déjà parce qu'à l'époque le style Ozu, s'il était déjà maitrisé, n'avait pas encore atteint le naturel et la fluidité dans l'exécution des films de sa période couleur. Du point de vue du ton, le film brille par son unité, l'utilisation du montage cherche à créer une impression de fatalisme, de sérennité alors que ce qui est décrit est on ne peut plus triste, une forme de sagesse face au changement des choses fut-il négatif. Sans y parvenir totalement parce que les plans longs sont parfois un peu trop longs, nuisant un peu à l'émotion reposant dans les meilleurs Ozu dernière période sur un équilibre fragile créé par la précision du montage et qui donne une sensation d'écoulement naturel des choses ne se transformant jamais en endormissement.
Au rayon films panthéonisés auxquels j'aurai à faire de gros reproches sans pour autant que ça remette en cause leur statut, après le Faucon Maltais (1) et Quand la Ville Dort (1), voilà ce Voyage à Tokyo souvent cité parmi les sommets du cinéma mondial dans les sondages critiques ou de cinéastes. Parce qu'à mes yeux si le film a d'indéniables qualités il ne saurait soutenir la comparaison en termes d'accomplissement artistique dans un genre donné -le drame- (je conçois que ce ne soient pas des oeuvres directement comparables d'où cette remarque) avec Les Contrebandiers de Moonfleet, Rio Bravo ou Vertigo par exemple pour citer des habitués des référendums critiques. Déjà parce qu'à l'époque le style Ozu, s'il était déjà maitrisé, n'avait pas encore atteint le naturel et la fluidité dans l'exécution des films de sa période couleur. Du point de vue du ton, le film brille par son unité, l'utilisation du montage cherche à créer une impression de fatalisme, de sérennité alors que ce qui est décrit est on ne peut plus triste, une forme de sagesse face au changement des choses fut-il négatif. Sans y parvenir totalement parce que les plans longs sont parfois un peu trop longs, nuisant un peu à l'émotion reposant dans les meilleurs Ozu dernière période sur un équilibre fragile créé par la précision du montage et qui donne une sensation d'écoulement naturel des choses ne se transformant jamais en endormissement.
Pour le reste, on retrouve l'art de l'ellipse d'Ozu (quoi que les plans de trains ne soient pas des modèles de symbolisme subtil; du coup, on en voudrait presque à Ozu d'avoir inauguré ces lourdes métaphores ferroviaires un peu trop présentes dans le cinéma coréen contemporain), sa capacité à montrer que plan fixe ne signifie pas absence de mise en scène comme elle le sera chez certains "suiveurs" festivaliers du bonhomme (cette idée de génie qu'une distance -éloignée des personnages-, un cadrage -les fameux plans à hauteur de tatami- et un montage -la lenteur- racontent la culture d'un pays), ses thèmes fétiches (la question des rapports entre les générations, la solitude des etres, le fatalisme face à la mort), une direction d'acteurs d'une grande subtilité (en particulier pour ce qui concerne Hara Setsuko), une multiplication des personnages donnant une dimension romanesque à un récit intimiste et également le reproche général qu'on pourrait faire à l'oeuvre d'Ozu (mais aussi à Rohmer par exemple): refaire toujours à peu près le meme film malgré quelques nuances d'une oeuvre à l'autre. Finalement, la réputation du film vient probablement en partie des circonstances de sa découverte en Occident: ce film d'Ozu fut un des premiers à y etre montrés et du coup suscita des vocations chez de jeunes cinéphiles et critiques de cinéma devenus aujourd'hui des figures de premier plan dans leurs domaines respectifs. Du coup, il bénéficie peut etre au centuple de ce fameux effet madeleine de Proust qui fait qu'un Tarantino cite pour des raisons personnelles Coffy (haut du panier de la blaxploitation, avec un vrai charme d'époque mais qui est loin d'etre du grand cinéma) dans ses films favoris aux cotés de vrais sommets du cinéma mondial signés Leone, Scorcese, Hawks et De Palma.
Petit bémol néanmoins: la déception exprimée ici provient sans doute de l'ordre dans lequel j'ai découvert les films d'Ozu: découvrir ce beau film après ceux de la période couleur, c'est un peu comme découvrir la Chevauchée Fantastique (autre favori des classements de critiques et de grands cinéastes) après la Prisonnière du Désert.
(1) Etablissant il est vrai un mythe cinématographique de platine nommé HB mais que j'ai toujours trouvé filmé platement et surtout manquant de personnages féminins forts, chose qui passe très bien dans les films d'aventure de Huston fondés sur l'amitié virile mais bien moins dans un film noir classique.
(2) Mieux filmé que le précédent, faisant exploser le temps de quelques séquences cultes une dénommée Norma Jean mais souffrant du meme problème niveau personnages féminins et un peu victime de sa descendance kubrickienne (The Killing) et tarantinienne (Reservoir Dogs) plus inspirée rayon film de casse.



