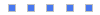Magnifique oeuvre de cinéma 
Pour son premier long-métrage, Park Jin-Sung reprend sensiblement la même méthode que celle appliquée par Epitaph, qu'il a également écrit : un film en trois actes, dont les histoires se recoupent même si les genres sont différent. Ainsi, VIY, qui est l'adaptation d'une oeuvre de l'auteur russe Gogol, commence par une séquence faisant monter la pression sur le spectateur sans lui faire dépasser la limite, utilisant beaucoup de codes du film d'horreur coréen tout en apportant la fraicheur d'une histoire globalement différente. Cela se remarque surtout dans la deuxième partie, tournée sur une scène de théâtre et sans presque aucun décor. La différence avec le théâtre étant que la vision du spectateur n'est pas limitée par l'endroit où il est assis ; la caméra change régulièrement de position pour focaliser une situation précise. On voit ainsi que le sujet n'a en fait rien à voir avec une histoire de fantôme, mais qu'il s'agit d'un conte sur une sorcière russe (d'ailleurs, dans cette partie, les noms et les lieux sont dans leur langue originale). Enfin, la dernière partie, qui vient recoller les derniers morceaux du récit, est dotée d'une ambiance magnifique et emprunte des plans des deux autres parties, changent régulièrement de piste pour dérouter le spectateurs, et finit sur une conclusion limpide et extrèmement bien amenée. Bref, une belle oeuvre originale et maitrisée. À noter également l'actrice principale époustouflante et hypnotique.
08 décembre 2008
par
Elise
Le spectacle des fantômes
Malgré la profonde crise cinématographique qu'il traverse, le cinéma coréen accouche tout de même d'une nouvelle génération de réalisateurs de talent, qui cherchent à bouleverser quelque peu les codes commerciaux figés pour s'approprier lu grand écran comme d'un véritable Art. Il en résulte d'œuvres aussi singulières, comme "Dining Table" et "Land of scarecrows" de Teddy Roh, d'un "Members of the Funerals" de Baek Seung-bin ou d'un "Viy" de Park Jin-sung. Une œuvre d'autant plus audacieuse, que ce jeune réalisateur tente passablement de changer la donne même de l'un des genres les plus éprouvés du cinéma coréen (voire asiatique en général), celui du film d'horreur; genre, qu'il avait déjà su renouveler par son précédent et intéressant scénario "Epitaph". Sauf qu'à la différence de la précédente génération des cinéastes, qui avaient su amener le cinéma coréen sur un premier plan mondial en 1997, la nouvelle génération manque de la fougue et de la niaque revendicatrice de l'ancienne génération ayant encore grandie sous le joug d'un régime dictatorial. La plupart des réalisateurs de la nouvelle génération ont – au contraire – grandi durant la faste période politique et économique de l'après-régime et s'avèrent pour la plupart soit des metteurs en scène se souhaitant couler dans le "moule" formaté par les grands studios pour rêver de gloire, célébrité et gros sous ou alors sont des fils à papa aux goûts bobo un peu trop prononcés pour vraiment convaincre et qui accouchent d'œuvres prétentieuses nombrilistes. "Viy" s'avère honnête dans sa démarche, mais un brin trop autarcique pour pleinement convaincre.
Cette nouvelle adaptation (après celle, russe, de 1967) d'une courte nouvelle de Gogol (l'extraordinaire "Journal d'un fou", l'un de mes livres de chevet) est donc avant tout un exercice de style un peu particulier, puisqu'après une première partie déjà relativement austère, la seconde partie bascule directement sur les planches d'un théâtre avec ce qui ressemble au filmage (mis en scène) de la répétition d'une pièce. Personnellement grand fan de théâtre (et acteur amateur), j'ai toujours eu un peu de mal avec la volonté de filmer une représentation théâtrale: la caméra crée une distance dans un décor qui fait déjà toc et il est difficile d'adhérer à un jeu d'acteur souvent outrancier sans être soi-même impliqué dans le spectacle ."Viy" me donne exactement cette même distanciation dans une bien trop longue seconde partie, s'entremêlant, certes, habilement avec la première partie, mais ressemblant par trop à un simple exercice de style, plutôt qu'un véritable long-métrage. Le film est en fait tout à l'image de cette image finale, où les acteurs saluent un public imaginaire, ou du moins invisible, en effectuant la traditionnelle courbette sur les planches d'un théâtre en tournant le dos au spectateur du film: un exercice, qui ne se serait pas adressé au spectateur du film, mais à quelque autre entité invisible et qui nous laisse ainsi singulièrement sur le carreau sans jamais nous impliquer émotionnellement. Personnellement, je préfère relire la nouvelle originale ou revoir la version 1967.