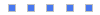

| Xavier Chanoine | 4.25 | Un conte macabre effrayant jusque dans son final extraordinaire |
L’un des plus beaux films de Shinoda Masahiro est accessoirement l’un de ses plus effrayants. Remarque, les deux font la paire, on a pu voir ce que cela donnait chez Kobayashi Masaki ou Shindo Kaneto, leurs œuvres les plus marquantes sont les plus singulières et le plus terrifiantes à la fois. Dans ce film d’une simplicité extrême, adaptée du célèbre écrivain d’après-guerre Sakaguchi Ango, le cinéaste nous plonge dans un Japon féodal où la légende raconte qu’il n’est pas bon de marcher sous les cerisiers lorsqu’ils sont en pleine floraison : les pétales d’un rose pâle encerclent ainsi les passants égarés et leur murmurent une douce folie. Preuve en est ces moines perdus se mettant subitement à jeter leur chapeau en l’air et prendre la fuite tel un troupeau de loups face à l’Homme et sa torche. Cette séquence, magistralement mise en scène, annonce le magnifique mélange des genres de Under the Blossoming Cherry Trees, où la plus grande beauté picturale d’un maître en la matière (Suzuki Satsuo, l’un des trois quatre grands de l’image du cinéma nippon) côtoie l’outrageant et l’ignoble tout en gardant en ligne de mire ce savoir-faire des studios, cette mythologie du sabreur qu’il soit bon ou mauvais. Il ne s’éparpille pas, reste chambara le temps de quelques séquences de découpe bien exécutées sans être non plus des sommets de tension. Mais il est aussi cadavérique, pourris de crasse et d’horreurs les plus insoutenables dans le fond : une jeune femme, belle et soyeuse, se fait capturer par un gros ours interprété par Wakayama Tomisaburo, assez génial d’ailleurs. Mais étrangement la jeune femme se trouve être hautaine et capricieuse, exigeant de son kidnappeur les pires crasses pour qu’elle soit digne d’être sa dite femme. Fasciné par sa beauté, le malheureux n’aura pas l’occasion de résister bien longtemps à ses avances sous peine de la perdre. Cet amour motivé par le simple désire du corps, de la chair, est matérialisé par le fétichisme absolu de la jeune femme pour la mort, la putréfaction. A l’image de certains classiques poético-macabres d’artistes transalpins aussi différents que complémentaires sur certaines thématiques, à savoir Pasolini ou D’Amato, Under the Blossoming Cherry Trees partage cette même passion pour la peinture du genre humain de première approche tout à fait banal, mais qui se révèle être en fin de compte plus terrifiant qu’il ne laissait supposer. L’un des premiers trompe-l’œil réside surement dans la beauté de la captive. Mais combien d’êtres cachés sous un voile (un premier indice) et une tonne de maquillage sont des trompe-l’œil ? A la manière des fantômes japonais, les plus beaux sont les plus démoniaques.


Mais au-delà de son caractère macabre très premier degré (malgré des maquillages vieillis), le film de Shinoda est une magnifique ode à l’amour aveugle, presqu’impossible en dehors de l’acte lui-même. Le personnage joué par Wakayama Tomisaburo en est même pathétique, presque blessé dans son amour propre par une jeune inconnue le possédant grâce à sa beauté : ce dernier passera donc du bandit des grands chemins, fier au possible, à un pauvre guignol déguisé en mendiant le temps d’aller trouver quelques têtes à découper pour sa belle. Ce dernier est prêt à descendre de son échelle sociale (plus haute que le peuple, logique lorsque l’on est fine lame) pour se retrouver parmi le peuple, ces gens qu’il n’observe que pour mieux les dépouiller par la suite. D’ailleurs il est aussi intéressant de noter que, incapable de sortir de ses montagnes, le grand gaillard va découvrir la ville comme un enfant maladroit : il ne sait pas se servir de la monnaie, ne connait pas les us et coutumes de la ville. L’agresseur devient à son tour, socialement, agressé. Riche, ce Under the Blossoming… ? Oui, définitivement. Shinoda Masahiro mêle donc à merveille film de genre et vrai film d’auteur au sens noble du terme en saupoudrant son œuvre macabre de touches politiques passionnantes comme en témoigne ce fait pas assez évoqué dans le cinéma japonais, à savoir ces criminels qui deviennent instantanément officiers de la loi en acceptant à leur tour de traquer les bandits. Est aussi évoqué la condition des « oubliés », ceux que l’on terre dans des box pour s’en servir comme esclaves, à l’image de ces femmes en début de métrage assassinées une par une suite au caprice de la récente captive. Ces tueries témoignent de la folie fétichiste de cette dernière, trouvant le plaisir et la satisfaction dans le massacre à la pelle. Il ne serait d’ailleurs pas étonnant de comparer le repère de l’homme de la montagne à un véritable tombeau au fur et à mesure que le film avance. Mais cette folie conduira les deux êtres à un destin tragique sous les cerisiers en fleurs, dans une séquence mémorable à tous les niveaux de par sa poésie macabre, quasi spectrale et son exécution. A l’image des quelques séquences filmées sous ces magnifiques arbres, Shinoda a recours au ralenti et démontre à quel point le ralentissement peut provoquer la peur, le malaise, l’hypnose, par la simple mise en scène mêlant efficacement score glaçant (signé par deux grands qu’on ne présente plus) et images sorties de l’au-delà. Comme si le Rêve de Kurosawa rencontrait les démons de Shindo Kaneto. Du grand art.