Le réveil de la bête
 Même s’il est difficile de comprendre la raison d’être d’un tel film, il est par contre facile de se laisser porter par cette représentation théâtrale du Japon d’après guerre, un retour à l’âge de pierre en carton-pâte (1) où l’homme et la femme dénués de repères n’ont d’autre recours rassurant que de se vautrer dans la luxure, l’alcool et la bouffe pour oublier leurs poches vides et satisfaire leurs âmes perturbées. Ainsi les corps sont-ils toujours en nage, les poses lascives, les instincts primaires et la morale secouée, une morale affreusement absente de ce film, une barrière entre bien et mal qui ne serait justifiée que si les hommes en avaient les moyens. Au milieu de cette imagerie barbare plutôt réussie (2) on tente tant bien que mal de suivre le cheminement d’une des rares personnes assimilables à une citoyenne un peu cultivée, cette femme conservant un look périmé et un comportement détonnant au milieu de toutes ces femelles peu farouches. Elles le deviendront pourtant lorsque cette différence les mettra en retrait aux yeux de leur homme, celui avec un grand « H », un mac choisi par ces femmes - et semble t'il par le destin - comme protecteur et objet de désir. Cette « citoyenne » qu’on admire, une « vraie femme » comme l’appelle justement H-man, c'est une lady pour laquelle on apprécie sa capacité à suivre une ligne de conduite, celle qui la destine à un autre homme manifestement brave, honnête, sympa et… et non, car elle finira par succomber comme les autres au fantasme du mac ultra viril sans qu’aucun remord ni même aucune hésitation ne la dérange le moins du monde. Dérangeant ? Oui et non, c’est juste humain, il n’est pas besoin de remonter si loin pour voir ça, simplement le discours de Suzuki est trop contradictoire et bordélique pour que l’on comprenne bien le truc, d’où cette impression assez vertigineuse qu’il en faut peu pour également flinguer les repères du spectateur et l’impliquer malgré lui dans ce basculement barbare. En cela ce film est donc très réussi, même si l’on est en droit d’être rebuté par autant de pessimisme et même s’il est vrai que la vie, la vraie, ne doit pas être si éloignée que ça d’un tel bazar, bazar sans paillettes à l'époque pour "sauver" les apparences et masquer une animalité ne cherchant qu'à s'exprimer.
Même s’il est difficile de comprendre la raison d’être d’un tel film, il est par contre facile de se laisser porter par cette représentation théâtrale du Japon d’après guerre, un retour à l’âge de pierre en carton-pâte (1) où l’homme et la femme dénués de repères n’ont d’autre recours rassurant que de se vautrer dans la luxure, l’alcool et la bouffe pour oublier leurs poches vides et satisfaire leurs âmes perturbées. Ainsi les corps sont-ils toujours en nage, les poses lascives, les instincts primaires et la morale secouée, une morale affreusement absente de ce film, une barrière entre bien et mal qui ne serait justifiée que si les hommes en avaient les moyens. Au milieu de cette imagerie barbare plutôt réussie (2) on tente tant bien que mal de suivre le cheminement d’une des rares personnes assimilables à une citoyenne un peu cultivée, cette femme conservant un look périmé et un comportement détonnant au milieu de toutes ces femelles peu farouches. Elles le deviendront pourtant lorsque cette différence les mettra en retrait aux yeux de leur homme, celui avec un grand « H », un mac choisi par ces femmes - et semble t'il par le destin - comme protecteur et objet de désir. Cette « citoyenne » qu’on admire, une « vraie femme » comme l’appelle justement H-man, c'est une lady pour laquelle on apprécie sa capacité à suivre une ligne de conduite, celle qui la destine à un autre homme manifestement brave, honnête, sympa et… et non, car elle finira par succomber comme les autres au fantasme du mac ultra viril sans qu’aucun remord ni même aucune hésitation ne la dérange le moins du monde. Dérangeant ? Oui et non, c’est juste humain, il n’est pas besoin de remonter si loin pour voir ça, simplement le discours de Suzuki est trop contradictoire et bordélique pour que l’on comprenne bien le truc, d’où cette impression assez vertigineuse qu’il en faut peu pour également flinguer les repères du spectateur et l’impliquer malgré lui dans ce basculement barbare. En cela ce film est donc très réussi, même si l’on est en droit d’être rebuté par autant de pessimisme et même s’il est vrai que la vie, la vraie, ne doit pas être si éloignée que ça d’un tel bazar, bazar sans paillettes à l'époque pour "sauver" les apparences et masquer une animalité ne cherchant qu'à s'exprimer.
(1) « Fais gaffe à ton décors car ton plâtre laisse à désirer !! » Spéciale dédicace à cette église, une sorte de manoir du mal (l’occident) peu crédible et surtout bien kitch... Cela dit ça marche.
(2) « Spéciale dédicace 2, le retour » pour cette scène gore où une vache se faire massacrer avec en juxtaposition une prostituée nous montrant sans aucune gêne son généreux décolleté. Effet garanti.
Ruines théâtrales 
Historique, esthétique, chaotique, bordélique...
Amour, rires, bestialité, humanité, pureté, saleté...
Tokyo en ruine, après guerre, G.I. en rut, 3 garces prostituées, 1 fille fragile et influençable, 1 femme qui tente tant bien que mal de le rester ou de le redevenir, un soldat vaurien allumé et sans illusion qui s'impose comme LE mec idéal au milieu des femelles...
Une tentative vaine de garder sa dignité humaine alors qu'ici, plus on essaie de se réhumaniser, de sortir du chaos, plus on se désolidarise des bas fonds, de la bestialité règnante...
Mélangeant sans gêne le réalisme le plus poussé au surréalisme visuel le plus débridé.... Ma-gni-fique !
nb : à part ça, je trouve l'analyse de maggielover assez pertinente ce qui n'empêche en rien le fait que ce film soit ma-gni-fique, le meilleur de Suzuki que j'ai pu voir.
un superbe tableau du Japon d'après-guerre 
Petit rappel historique tout d'abord. Dans les années 60, la Nikkatsu au bord de la faillite se lance dans la production de roman porno (films romantiques-pornographiques) destinés à satisfaire les fantasmes d'un certain public. A cette époque, la compagnie compte des cinéastes capables d'utiliser le cahier des charges du genre pour imposer leur vision. Parmi eux, Seijun Suzuki.

La voix off du début du film pose le sujet de façon saisissante: "Après guerre, Tokyo était une jungle.". Dès lors, seule compte la survie et la fin justifie les moyens. Dans ce contexte, un groupe de jeunes femmes décide de se prostituer. Une des belles idées du film est la scène où elles se font tatouer les unes après les autres. Ce rite fait écho à l'initiation des yakuzas. Dès lors, le film va filer le parallèle entre leur trajectoire et l'explosion du phénomène yakuza après-guerre au Japon. La règle du sexe non tarifé et les tortures qui suivent sa violation rappellent le code d'honneur des yakuzas et leurs fameux doigts coupés en cas de violation. Ce parallèle sera renforcé par l'irruption d'un ancien militaire en fuite (joué par un Jo Shishido magistral) dans les groupe de femmes: il s'imposera comme leur chef parce que comme elles il n'a aucun principe, n'a plus rien à perdre, est motivé par l'instinct de survie et voit les relations comme des rapports de force. Son initiation progressive au vol et à la contrebande fait écho au parcours des jeunes femmes.
Le film dresse un tableau noir du Japon d'après-guerre: Gi's violeurs (la glaçante scène de viol du début) et ne respectant pas les locales, vol comme moyen de survie, règne du marché noir, explosion du phénomène yakuza, complicité mafia-GI's.

Dans ce contexte, la caméra prend le parti de ses héroines, les montre commes des femmes fortes qui savent se faire respecter de leur client. Elle va jusqu'à adhérer à leurs fantasmes (les scènes de reve sublimement photographiées où l'une d'elles se voit violant un pasteur, tuant le militaire en fuite, lui faisant l'amour parce qu'il lui rappelle son frère mort au front, les héroines se voyant dans un environnement idyllique) et à les montrer fières de leur marginalité. Comme dans les meilleurs mélodrames américains, les habits portés par les héroines reflètent parfaitement leurs émotions si bien qu'elles semblent ne faire qu'une avec les couleurs de ces habits.
A l'instar des autres films de Suzuki en couleur, Gate of Flesh se caractérise par ses cadrages au cordeau, sa photographie aux chromas riches et variés et ses thèmes musicaux décalés avec le récit (l'Internationale, les rythmes africains).
Le final où le militaire en fuite périra à cause de son seul acte non cynique est cruel mais cohérent avec le propos du film qui dépeint un monde où l'absence repères est devenue le norme.
Du cinéma sérieux.
Seijun Suzuki dépeint dans un cadre glauque et bordélique un Japon d'après-guerre, en pleine occupation américaine. Le cadre est glauque, les ordures remplissent un environnement occupé par des pêcheurs, des militaires et surtout, des prostituées. Ce sont d'ailleurs elles, les véritables héroïnes du métrage.
Regroupées dans une sorte de manoir improvisé où se déroulent sévices et dépravations, elles sont les véritables reines des lieux et font clairement respecter leur autorité. Les hommes viennent, tirent leur coup et paient, rien d'autre. Les sentiments sont à part, elles servent uniquement de "chair" et l'assument entièrement. Pour preuve, une des prostituées se fera passer à tabac par ses collègues devant l'homme qu'elle dit aimer. Humiliation et torture sont au rendez-vous, on ne rigole pas dans cette maison close.
Le film de Suzuki pencherait presque du côté du cinéma d'exploitation, qui se verra être populaire avec Meiko Kaji en Lady Snowblood ou encore Scorpion, presque 10 ans plus tard. Le film est donc traité sur un ton parfois guilleret, un peu frou-frou sur les bords, Suzuki nous offrant une sorte de film d'aventure sous fond de comédie érotique, au message social bien présent. Souvent très dur et pour le moins cruel, La barrière de la chair est un véritable cocktail détonnant, superbement réalisé (Scope, couleurs exotiques, sens du cadre) et par moment hystérique.
Les + :
- Réalisation exemplaire
- Les prostituées déjantées
- Parfois baroque, souvent bis.
Les - :
- L'alchimie comédie/érotisme/drame peut rebuter.
Vous avez dit sérieux? 
S'il y a un film dans lequel suzuki se rapprche de l'esprit de sérieux, c'est bien dans cette Barrière de chair. Tous les éléments sont là: portrait de femme, catégorie minorisée s'il en est dans la société japonaise traditionnelle, portrait du Japon d'après-guerre ensuite, lieu commun de pleins de films sérieux parfaitement géniaux (Combat sans code d'honneur, Le détroit de la faim, entre autres...),... autant de choses qui semblaient diriger le film vers une fresque enfin sérieuse pour Suzuki, et il n'est pas improbable que le réalisateur dissimule sous sa gouaille de roublard génial ses propres incertitudes quant à ces questions. Maggielover a parfaitement mis en avant tous les éléments qui font que malgré tout ce film ne pourra jamais être pris totalement au sérieux. Publicité criarde certes, trop "putassière" et détournée que pour être honnête. Au final, la Barrière de chair est le film le plus ambigu de Suzuki, celui qui se pare le plus des attributs du film à thèse, mais partant aussi le plus malin... ou le plus vicelard! c'est selon.
à voir absolument 
tout est dans mon titre
Emblématique 
Un des deux ou trois films les plus emblématiques du vieux cinéaste, LA BARRIERE DE CHAIR est une transposition sur grand écran de la comédie humaine dans toute sa cruauté et son réalisme.
SUZUKI en parfait esthète choisit pour décor principal des ruines, en y associant les couleurs vives des robes de ses héroïnes à la vulgarité tapageuse et à la charge érotique constante, créant autour le tableau baroque et flamboyant d’une ville en pleine reconstruction livrée au marché noir et à la violence quotidienne.
Joe SHISHIDO promène son physique étrange dans cette moiteur, parfait anti-héros et représentation du mâle dominant qui va perturber un univers codifié par la survie à tout prix.
LA BARRIERE DE CHAIR est devenu justement un incontestable classique, un des meilleurs long-métrages traitant de l’immédiat après-guerre japonais, une histoire sombre ou les visages faussement enjoués cachent mal une amertume à fleur de peau. Et un film qui vieillit bien.
Ceux qui m'aiment prendront le pont
"La barrière de chair" est une bonne blague graveleuse comme seuls les japonais savent en servir. Technicolor, Metrocolor, De Luxe, le surlignage botticellien (Skorecki) de Minnelli ou Donen contre les aplats violents de Nicholas Ray ou King Vidor, tout est une question de couleurs, de publicité criarde, d'effet d'annonce tape-à-l'oeil. Grand film expérimental et piège à cons, "La barrière de chair" est donc une façon de tromper la chair par la multiplication des stratégies de dissimulation travesties en libido para-érotique. Rien n'est assez bon, ou assez foutraque, pour que de cette chair dont on nous annonce tout, finalement on n'en voie jamais rien. Corps éteints sous les vêtements, les ombres et les décors felliniens, les prostituées n'exposent rien, ne donnent rien, n'offrent rien, même pas le manque qui ouvrirait le désir à sa propre machinerie. Non-prostituées qui se font baiser dans des bunkers (mais on ne les voit jamais), non-femmes qui aspirent à le devenir, japonaises qui aimeraient bien être américaines (connes, mais riches), les prostituées de "La barrière de chair" ne le sont que pour rire. Ce qui compte, là où la chair apparaît, c'est dans les mortifications sado-lesbiennes qu'elles s'infligent entre elles - entre gamines excitées par l'entrée en scène d'un mâle musclé et luisant, un homme un vrai. Mais autant dire un homme en toc, comme tout chez Seijun Suzuki : l'effet de réel, chez lui, tient toujours de l'as malicieux planqué dans une manche. "La barrière de chair", alors, c'est d'abord celle du regard. L'oeil, la chair, nous. Que voulons-nous voir, que désirons-nous voir ? Tout : la chair. Seijun Suzuki répond : alors vous ne verrez rien - rien de cette chair. Mais il y a tout le reste : les couleurs, le stuc, les ficelles tordues et les trucages bancaux. Tout le reste, c'est-à-dire le cinéma. Seijun Suzuki, grand cinéaste, savait très bien que le cinéma, c'est de la blague. "La barrière de chair" l'avait bien fait rire.
Un putain de chef d'oeuvre !! 
Beau , violent , fascinant mais bien plus encore ...
Oeuvre d'Art 
Beau, troublant, sensuel, emouvant...et légèrement teinté de sado-masochiste .
Que dire de plus, les mots me manquent...
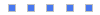



 Même s’il est difficile de comprendre la raison d’être d’un tel film, il est par contre facile de se laisser porter par cette représentation théâtrale du Japon d’après guerre, un retour à l’âge de pierre en carton-pâte (1) où l’homme et la femme dénués de repères n’ont d’autre recours rassurant que de se vautrer dans la luxure, l’alcool et la bouffe pour oublier leurs poches vides et satisfaire leurs âmes perturbées. Ainsi les corps sont-ils toujours en nage, les poses lascives, les instincts primaires et la morale secouée, une morale affreusement absente de ce film, une barrière entre bien et mal qui ne serait justifiée que si les hommes en avaient les moyens. Au milieu de cette imagerie barbare plutôt réussie (2) on tente tant bien que mal de suivre le cheminement d’une des rares personnes assimilables à une citoyenne un peu cultivée, cette femme conservant un look périmé et un comportement détonnant au milieu de toutes ces femelles peu farouches. Elles le deviendront pourtant lorsque cette différence les mettra en retrait aux yeux de leur homme, celui avec un grand « H », un mac choisi par ces femmes - et semble t'il par le destin - comme protecteur et objet de désir. Cette « citoyenne » qu’on admire, une « vraie femme » comme l’appelle justement H-man, c'est une lady pour laquelle on apprécie sa capacité à suivre une ligne de conduite, celle qui
Même s’il est difficile de comprendre la raison d’être d’un tel film, il est par contre facile de se laisser porter par cette représentation théâtrale du Japon d’après guerre, un retour à l’âge de pierre en carton-pâte (1) où l’homme et la femme dénués de repères n’ont d’autre recours rassurant que de se vautrer dans la luxure, l’alcool et la bouffe pour oublier leurs poches vides et satisfaire leurs âmes perturbées. Ainsi les corps sont-ils toujours en nage, les poses lascives, les instincts primaires et la morale secouée, une morale affreusement absente de ce film, une barrière entre bien et mal qui ne serait justifiée que si les hommes en avaient les moyens. Au milieu de cette imagerie barbare plutôt réussie (2) on tente tant bien que mal de suivre le cheminement d’une des rares personnes assimilables à une citoyenne un peu cultivée, cette femme conservant un look périmé et un comportement détonnant au milieu de toutes ces femelles peu farouches. Elles le deviendront pourtant lorsque cette différence les mettra en retrait aux yeux de leur homme, celui avec un grand « H », un mac choisi par ces femmes - et semble t'il par le destin - comme protecteur et objet de désir. Cette « citoyenne » qu’on admire, une « vraie femme » comme l’appelle justement H-man, c'est une lady pour laquelle on apprécie sa capacité à suivre une ligne de conduite, celle qui 





