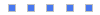
Une chose est à peu près sûre, le 4ème Festival franco-coréen du film a revu cette année ses ambitions à la hausse. Fort d’une réputation toujours grandissante, auprès de la communauté coréenne de Paris et des cinéphiles d’un soir, le festival, toujours organisé par la même équipe, continue sur une lancée qui est celle de faire découvrir aux parisiens un ou plusieurs visages du cinéma coréen, qu’il soit contemporain ou d’un autre âge. On notera en effet cette année une volonté de projeter des œuvres plutôt rares voir complètement invisibles en France, comme ce focus sur les films de propagande tournés durant l’ère dictatoriale de Park Chung-Hee au cours des années 60 et 70. La curiosité est en définitive le maître mot de ce festival, contenant son lot de surprises assez formidables comme d’autres qui le sont beaucoup moins, mais c’est ce qui donne également toute la saveur à un festival.


C’est par une nuit de novembre plutôt fraîche que nous attaquons cette 4ème édition, avancée au niveau de l’agenda, si l'on compare à l’an dernier. Qu’importe, les habitués sont encore de la partie, l’Action Christine n’a pas changé de couleur, les installations non plus. Pourtant, le festival semble attaquer d’entrée de jeu avec une sacrée carte : celle de la gifle qu’on ne présente plus en ces colonnes, à savoir la projection de Breathless du tout jeune cinéaste Yang Ik-Jun. Avant que le film ne commence, une partie des organisateurs bénévoles présentèrent le festival, dont notre ami Gilles, qui se sera essayé au coréen devant une salle absolument comble pour l’occasion. La cérémonie d’ouverture a d’ailleurs provoqué quelques rires dans le public, notamment suite à la prise de parole d’un représentant coréen d’une compagnie aérienne, visiblement très heureux d’être présent ce soir là. C’est aussi tout le charme d’un festival indépendant, ces petits imprévus, ces moments de solitude, ces soucis de micros…
Breathless ouvrait donc le festival. Histoire d’afficher les ambitions d’un festival transformé pour l’occasion en distributeur de gifles automatique, copie 35mm, conditions optimales pour démontrer combien le récent cinéma coréen, du moins une partie, a des choses à dire et à envoyer dans la rate lorsqu’il ne nous abreuve pas de films larmoyants par paquets de douze. Logique d’un cinéma de plus en plus commercial. Néanmoins, Breathless sort du lot par son éreintante violence, désagréable et interminable. « -minable » aussi, pourrait-on dire. Reflet d’une société pauvre, laissée à la dérive, et dont ses petits soldats improvisés sont même abandonnés par leur propre famille. Explosion du cercle familial, des émotions, une violence qui se substitue aux larmes. Tout le personnage de Sang-Hun, joué par Yang Ik-Jun dont la vocation est d’être acteur avant tout. Et quelle rage, une mollesse paradoxalement brutale, excessive et jusqu’au-boutiste lorsqu’il est question de distribuer des pains ou de cracher sur tout ce qui bouge. A côté, l’humanisme d’une lycéenne franc du collier, la géniale Kim Kot-Bi. Rencontre entre les deux, coup « d’éclat » soudain puis une amitié naissante, entre deux mots doux. On en parle davantage ici.
 Le lendemain passait Rough Cut, bande économique parfois furieuse réalisée par Jang Hun, l’un des derniers protégés de Kim Ki-Duk qui avait déjà fait ses marques entre autres avec L’Arc et Time. Parabole plutôt bien faite du « double », confrontation assez anecdotique mais intéressante entre une star de cinéma et un gangster qui s’improvise acteur le temps d’un tournage, où les scènes de combat ne sont pas simulées, Rough Cut dresse le portrait de deux hommes tiraillés : l’un par une jeune femme, l’autre par lui-même. Effectivement, Kang-Pae est un malfrat avant d’être acteur de cinéma, et il est difficile pour lui de l’oublier : chorégraphies se terminant en bagarres de rue, séquence de viol –avortée à temps- pas tout à fait simulée à bord d’une voiture, magouilles en parallèle, le personnage ne sait plus sur quel pied danser. Choisir de continuer dans le chemin de l’ombre, opter pour la rédemption, difficile de choisir au final. Il est à ce propos le personnage le plus intéressant de l’histoire. Les rôles féminins sont sans saveur, Kang Ji-Hwan, pourtant l’acteur principal, est loin de recueillir tous les suffrages du fait d’incarner un personnage parfois antipathique. On se retournera du côté du personnage du réalisateur, attachant et passionné. Rough Cut un film d’homme, donc ? Des hommes qui, derrière leur costard et leurs berlines aux vitres teintées, sont aussi des grands enfants, des gens normaux. On pense à cette séquence d’improvisation d’une chorégraphie martiale entre Kang-Pae et l’un de ses gangsters, au ralenti, rappelant les grands enfants de l’œuvre d’un Kitano Takeshi, avec la bagarre en champ et un autre gangster amusé face au spectacle, en contre-champ. Pourtant, le film ne fait pas souvent preuve d’une grande maîtrise formelle. Kim Ki-Duk a beau être coscénariste et en partie producteur, sa patte n’effleure que très rarement le métrage malgré la thématique de la religion présente en filigrane, apportant une dimension intéressante bien qu’utilisée de manière souvent maladroite. Les scènes de combats sont filmées comme n’importe quel film de bagarre un minimum carré, sans poussées de géni malgré des décors qui pouvaient donner une certaine ampleur, comme ce terrain de boue désaffecté lors du combat final. De plus, Rough Cut est à l’image de ses personnages, incapable de trouver une identité : entre actionner bourrin à la Besson, film d’auteur et mélodrame qui n’a d’intérêt que de dégainer les violons aux moments propices. Mais au-delà de ces problèmes (confirmant sa belle popularité en Corée du sud), Rough Cut reste sympathique, agréable à suivre malgré ses longueurs, et respectant son beau ratio bavardage/torgnoles brutales.
Le lendemain passait Rough Cut, bande économique parfois furieuse réalisée par Jang Hun, l’un des derniers protégés de Kim Ki-Duk qui avait déjà fait ses marques entre autres avec L’Arc et Time. Parabole plutôt bien faite du « double », confrontation assez anecdotique mais intéressante entre une star de cinéma et un gangster qui s’improvise acteur le temps d’un tournage, où les scènes de combat ne sont pas simulées, Rough Cut dresse le portrait de deux hommes tiraillés : l’un par une jeune femme, l’autre par lui-même. Effectivement, Kang-Pae est un malfrat avant d’être acteur de cinéma, et il est difficile pour lui de l’oublier : chorégraphies se terminant en bagarres de rue, séquence de viol –avortée à temps- pas tout à fait simulée à bord d’une voiture, magouilles en parallèle, le personnage ne sait plus sur quel pied danser. Choisir de continuer dans le chemin de l’ombre, opter pour la rédemption, difficile de choisir au final. Il est à ce propos le personnage le plus intéressant de l’histoire. Les rôles féminins sont sans saveur, Kang Ji-Hwan, pourtant l’acteur principal, est loin de recueillir tous les suffrages du fait d’incarner un personnage parfois antipathique. On se retournera du côté du personnage du réalisateur, attachant et passionné. Rough Cut un film d’homme, donc ? Des hommes qui, derrière leur costard et leurs berlines aux vitres teintées, sont aussi des grands enfants, des gens normaux. On pense à cette séquence d’improvisation d’une chorégraphie martiale entre Kang-Pae et l’un de ses gangsters, au ralenti, rappelant les grands enfants de l’œuvre d’un Kitano Takeshi, avec la bagarre en champ et un autre gangster amusé face au spectacle, en contre-champ. Pourtant, le film ne fait pas souvent preuve d’une grande maîtrise formelle. Kim Ki-Duk a beau être coscénariste et en partie producteur, sa patte n’effleure que très rarement le métrage malgré la thématique de la religion présente en filigrane, apportant une dimension intéressante bien qu’utilisée de manière souvent maladroite. Les scènes de combats sont filmées comme n’importe quel film de bagarre un minimum carré, sans poussées de géni malgré des décors qui pouvaient donner une certaine ampleur, comme ce terrain de boue désaffecté lors du combat final. De plus, Rough Cut est à l’image de ses personnages, incapable de trouver une identité : entre actionner bourrin à la Besson, film d’auteur et mélodrame qui n’a d’intérêt que de dégainer les violons aux moments propices. Mais au-delà de ces problèmes (confirmant sa belle popularité en Corée du sud), Rough Cut reste sympathique, agréable à suivre malgré ses longueurs, et respectant son beau ratio bavardage/torgnoles brutales.


Dès 1993 avec First Love, le cinéaste s’essaie à la peinture du premier amour d’une étudiante envers son professeur d’art dramatique. Formellement bricolé et à la texture unique, cette romance burlesque étonne aussi bien par sa fraîcheur encore intacte que par ses audaces formelles rappelant par ailleurs l’œuvre de Obayashi Nobuhiko, grand ci néaste de l’adolescence en provenance du Japon. Mais le plus drôle dans tout cela, c’est que toutes les formes d’expérimentation autour de l’image sont au final pas si nécessaires. Les poèmes affichés à l’écran sur un fond dessiné, les objets qui se mettent subitement à voler, les ralentis/accélérés ou encore les passages au noir et blanc sont autant de petites touches à la beauté toute naïve que des idées un brin futiles. Mais on s’en fiche tant le film respire la jeunesse, la naïveté, l’amour délicat d’une jeune fille qui connait pour la première fois un tel sentiment. Mais ce n’est pas la seule surprise, le film est une petite merveille de précision formelle : le formidable sens du cadre permet de décoder le cinéma de Lee Myung-Se, évoquant le temps qui passe, qui se fige, s’élargit. Ainsi, les objets volent, les saisons défilent, passent même à une allure effrénée, en quelques secondes. Du cinéma de haute volée au sens "aérien", mais trop inégal ou pas assez structuré pour être marquant. Car au final, ces plans longs n’interviennent qu’en fin de métrage, cette manière si aérée d’évoquer les premiers émois laisse place à l’ennui au cours d’une dernière demi-heure bien trop longue. Ce sera également le cas avec le beau et parfois très drôle Their Last Love Affair. Des scènes de ménage hallucinantes entre un couple secrètement formé pour quelques temps, composé d’une jeune femme et d’un homme marié et père d’un enfant. Scandale, car il est bien question d’adultère. Mais Lee Myung-Se se fiche de faire de son film une comédie dramatique traitant de l’adultère en Corée. Ce qu’il veut faire va au-delà de la simple satire sociale, le cinéaste se plait en effet à faire « du cinéma » avant toute chose, en évoquant comme à son habitude la temporalité, les opposés comme des corps en mouvement dans un cadre fixe, l’amour ou encore la haine, des éléments étroitement liés au cinéma finalement. Mais l’œuvre de Lee Myung-Se semble être également ancrée dans un rêve onctueux, prétexte aux expérimentations, tout en restant sage : Their Last Love Affair n’a sans doute pas fait exprès d’être une comédie dramatique, il est juste le produit d’un scientifique énervé de voir le cinéma qu’il chérie tant, devenir si uniforme et conformiste. Selon lui, Million Dollar Baby, ce n’est pas du cinéma (cf interview, bientôt publiée).
néaste de l’adolescence en provenance du Japon. Mais le plus drôle dans tout cela, c’est que toutes les formes d’expérimentation autour de l’image sont au final pas si nécessaires. Les poèmes affichés à l’écran sur un fond dessiné, les objets qui se mettent subitement à voler, les ralentis/accélérés ou encore les passages au noir et blanc sont autant de petites touches à la beauté toute naïve que des idées un brin futiles. Mais on s’en fiche tant le film respire la jeunesse, la naïveté, l’amour délicat d’une jeune fille qui connait pour la première fois un tel sentiment. Mais ce n’est pas la seule surprise, le film est une petite merveille de précision formelle : le formidable sens du cadre permet de décoder le cinéma de Lee Myung-Se, évoquant le temps qui passe, qui se fige, s’élargit. Ainsi, les objets volent, les saisons défilent, passent même à une allure effrénée, en quelques secondes. Du cinéma de haute volée au sens "aérien", mais trop inégal ou pas assez structuré pour être marquant. Car au final, ces plans longs n’interviennent qu’en fin de métrage, cette manière si aérée d’évoquer les premiers émois laisse place à l’ennui au cours d’une dernière demi-heure bien trop longue. Ce sera également le cas avec le beau et parfois très drôle Their Last Love Affair. Des scènes de ménage hallucinantes entre un couple secrètement formé pour quelques temps, composé d’une jeune femme et d’un homme marié et père d’un enfant. Scandale, car il est bien question d’adultère. Mais Lee Myung-Se se fiche de faire de son film une comédie dramatique traitant de l’adultère en Corée. Ce qu’il veut faire va au-delà de la simple satire sociale, le cinéaste se plait en effet à faire « du cinéma » avant toute chose, en évoquant comme à son habitude la temporalité, les opposés comme des corps en mouvement dans un cadre fixe, l’amour ou encore la haine, des éléments étroitement liés au cinéma finalement. Mais l’œuvre de Lee Myung-Se semble être également ancrée dans un rêve onctueux, prétexte aux expérimentations, tout en restant sage : Their Last Love Affair n’a sans doute pas fait exprès d’être une comédie dramatique, il est juste le produit d’un scientifique énervé de voir le cinéma qu’il chérie tant, devenir si uniforme et conformiste. Selon lui, Million Dollar Baby, ce n’est pas du cinéma (cf interview, bientôt publiée).
 Toutefois, il fallait attendre la soirée de clôture pour assister au véritable moment de poilade du festival, avec la projection d’un film d’animation culte des années 70, Robot Taekwon V. On pensait le film perdu à tout jamais avant qu’il ne soit retrouvé en 2003 puis restauré après deux longues années. Ce classique de l’animation coréenne bénéficia d’adaptations papier et vidéo et jouit d’une immense popularité en Corée du sud jusqu’à très récemment, où le long-métrage de 1976 restauré attira environ 600 000 spectateurs en une dizaine de jours. C’est un peu leur Goldorak à eux, leur super-héros en alliage blindé capable de sauver la Terre par ses saltos arrière parfaitement exécutés et ses mouvements de Taekwondo si élastiques ! Cette machine haute comme un immeuble de cinq étages combat des tas de ferraille contrôlés par l’abominable Dr. Kaff, scientifique devenu vilain à cause des moqueries sur son physique ingrat. On a connu meilleur prétexte à la rébellion, mais visiblement, on entretenait déjà une culture de la beauté au pays du matin calme. Voici donc qu’il dresse l’Empire Rouge, toute allusion à la politique est d’ailleurs interdite. En face, le Dr. Kim s’associe avant de mourir avec son beau et fringant fils Kim-Hoon, champion imbattable de Taekwondo, pour arrêter l’invasion. Mais plus encore que ses scènes d’action, nombreuses mais répétitives, Robot Taekwon V est un fourbi artistique monumental. Tout y passe dans un minimum de temps : patriotisme exacerbé lors d’un combat de Taekwondo gagné d’avance face aux vilains japonais et américains, jalousie et romance qui feraient passer Tout ce que le ciel permet (Douglas Sirk, 1955) comme un mélodrame de durs à cuir, petits oiseaux chantants et écureuils sortis du premier âge d’or des longs métrages Walt Disney, méchants caricaturaux et son scientifique perfide à lunettes qu’on croirait sorti du cinéma expressionniste allemand des années 20, bande-son foutraque digne d’un mauvais Toei des seventies, mauvais goût d’une direction artistique aléatoire ou souvent très cheap, et personnages bis sans aucun intérêt si ce n’est de faire du burlesque avec les moyens du bord. On pense au petit garçon à tête de théière, juste idiot, pour être polis. Mais que serait Robot Taekwon V sans cela ? Que serait-il sans ses situations expédiées à la vitesse de l’éclair, ses retournements glucoses et son aura kitsch envahissant une salle alors ralliée à sa cause ? Guère grand-chose. C’est pour cela qu’on l’aime, notre Robot Taekwon V et que l'on chante ses louanges sans fin. Dans une hystérie la plus totale, le film termina les débats d’une belle manière. Et quelle manière ! Il est à l’image du festival dans son ensemble, bricolé mais d’une immense générosité.
Toutefois, il fallait attendre la soirée de clôture pour assister au véritable moment de poilade du festival, avec la projection d’un film d’animation culte des années 70, Robot Taekwon V. On pensait le film perdu à tout jamais avant qu’il ne soit retrouvé en 2003 puis restauré après deux longues années. Ce classique de l’animation coréenne bénéficia d’adaptations papier et vidéo et jouit d’une immense popularité en Corée du sud jusqu’à très récemment, où le long-métrage de 1976 restauré attira environ 600 000 spectateurs en une dizaine de jours. C’est un peu leur Goldorak à eux, leur super-héros en alliage blindé capable de sauver la Terre par ses saltos arrière parfaitement exécutés et ses mouvements de Taekwondo si élastiques ! Cette machine haute comme un immeuble de cinq étages combat des tas de ferraille contrôlés par l’abominable Dr. Kaff, scientifique devenu vilain à cause des moqueries sur son physique ingrat. On a connu meilleur prétexte à la rébellion, mais visiblement, on entretenait déjà une culture de la beauté au pays du matin calme. Voici donc qu’il dresse l’Empire Rouge, toute allusion à la politique est d’ailleurs interdite. En face, le Dr. Kim s’associe avant de mourir avec son beau et fringant fils Kim-Hoon, champion imbattable de Taekwondo, pour arrêter l’invasion. Mais plus encore que ses scènes d’action, nombreuses mais répétitives, Robot Taekwon V est un fourbi artistique monumental. Tout y passe dans un minimum de temps : patriotisme exacerbé lors d’un combat de Taekwondo gagné d’avance face aux vilains japonais et américains, jalousie et romance qui feraient passer Tout ce que le ciel permet (Douglas Sirk, 1955) comme un mélodrame de durs à cuir, petits oiseaux chantants et écureuils sortis du premier âge d’or des longs métrages Walt Disney, méchants caricaturaux et son scientifique perfide à lunettes qu’on croirait sorti du cinéma expressionniste allemand des années 20, bande-son foutraque digne d’un mauvais Toei des seventies, mauvais goût d’une direction artistique aléatoire ou souvent très cheap, et personnages bis sans aucun intérêt si ce n’est de faire du burlesque avec les moyens du bord. On pense au petit garçon à tête de théière, juste idiot, pour être polis. Mais que serait Robot Taekwon V sans cela ? Que serait-il sans ses situations expédiées à la vitesse de l’éclair, ses retournements glucoses et son aura kitsch envahissant une salle alors ralliée à sa cause ? Guère grand-chose. C’est pour cela qu’on l’aime, notre Robot Taekwon V et que l'on chante ses louanges sans fin. Dans une hystérie la plus totale, le film termina les débats d’une belle manière. Et quelle manière ! Il est à l’image du festival dans son ensemble, bricolé mais d’une immense générosité.
2ème partie du compte rendu :
Interview de Lee Myung-Se
Interview de Yang Ik-June
Mes sincères remerciements à l'équipe entière du festival, pour leur disponibilité et leurs efforts.
Photos : CHOI Hyo-Jung
