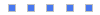
| J – Alors pour commencer, j'aimerais tout simplement savoir comment vous en êtes venu au cinéma. S – En fait, j'ai commencé par tourner des petits films en 8mm dès ma première année d'université et ensuite, plus ou moins par chance, je suis arrivé dans ce milieu et j'en ai fait mon métier. J – Mais avant cela, étiez vous cinéphile ? Vous interessiez vous déjà au cinéma ? S – J'aimais beaucoup ça mais à Fukuoka mon pays natal, il était impossible de voir des films d'art et essai. Alors j'y ai vu énormément de films de divertissement, pour la plupart assez mauvais. En fait, ce n'est que bien plus tard, quand j'ai été contraint de cesser de tourner pendant dix ans après Crazy Family que j'ai l'impression d'avoir découvert la véritable beauté du cinéma. L'impossibilité de réaliser des films m'a amené à a étudier et j'ai beaucoup appris durant cette période. Jusque là, j'ai l'impression d'avoir surtout oeuvré en autodidacte. Je me suis beaucoup inspiré de ce que faisaient d'autres réalisateurs sur d'autres films pour m'en sortir dans la réalisation des miens.
S – Le court métrage durait un quart d'heure. Il mettait en scène un adolescent qui rentrait dans son lycée et abbatait un de ses professeurs avec un revolver, sans raison. Par la suite, le lycée sombrait donc dans la panique jusqu'à l'arrestation du meurtrier. J – La même année vous co-réalisez une version longue de votre court pour une grosse compagnie, la Nikkatsu. Apparemment les choses se sont mal passées puisque vous dites renier ce film et n'être auteur que de 20 % de celui ci. Dans quelle mesure le résultat s'est il avéré différent de ce que vous aviez prévu de faire ? S – Par exemple, je ne voulais surtout pas donner de motivations au meurtrier et expliquer pourquoi il avait tué son professeur. Seul son acte m'interessait. De la même façon, je ne voulais pas faire rentrer des considérations psychologiques dans le film. Il n'y a que sa pulsion meurtrière et l'agonie de son professeur qu'il me paraissait interessant de représenter. Par la suite, je voulais montrer la lutte d'un adolescent devenu une machine contre des CRS devenus eux aussi des machines. Si j'en avais eu la possibilité, j'aurais même supprimés les dialogues. Les producteurs de l'époque n'ont pas compris ce que je cherchais à faire. Pourtant si j'avais aujourd'hui le possibilité de refaire ce film avec une pleine mainmise sur le projet, c'est probablement ainsi que je le ferais. A l ' époque on m'a dit que je n'étais qu'un amateur qui ne savait pas faire des films. C'est pour cela que j'ai claqué la porte des studios. J – Même si vous reniez en grande partie ce film, je lui trouve tout de même quelques qualités. Et en l'occurence, il m'évoque fortement un de mes cinéastes japonais favoris qui n'est autre que Hasegawa Kazuhiko. Dans Panique au Lycée on retrouve le même esprit, la même énergie, le même regard sur une génération. Sur le moment votre film m'a par exemple semblé très proche d'un des plus grands films japonais des années 70, The Man who Stole the Sun. Depuis j'ai appris qu'Hasegawa était aussi le producteur de Crazy Family. Quel rapport entretenez vous à l'homme et son cinéma ? Aviez vous vu ses films ? S – J'estime énormément le cinéma d'Hasegawa. Tout autant que le film que vous citez, je trouve son premier essai The Youth Killer absolument magnifique. Aujourd'hui il a environ 60 ans mais il n'a plus jamais tourné. C'était pourtant une personnalité vraiment influente et charismatique pour les jeunes générations de mon époque. Ses personnages qui tentaient de s'affranchir de leur existence étaient très importants pour nous. A l'époque, Hasegawa, Kurosawa Kyoshi et moi même nous étions très amis. Nous avions même fondé une société de production ensemble. Le tout premier film de Kurosawa Kyoshi et mon Crazy Family existent avant tout grâce à Hasegawa à qui nous devons beaucoup. C'est un homme vraiment très interessant même s'il vaut mieux ne pas l'approcher quand il est saoûl parce qu'il devient très violent ! (rires) J – Crazy Thunder Road, votre film suivant a été présenté au festival comme l'un des dix films préferés de Kitano Takeshi. Quel regard portez vous rétrospectivement sur lui et comment le situez vous dans le paysage du cinéma Japonais de l'époque ? S – Je ne savais pas que c'était l'un des films préferés de Kitano, cela me fait très plaisir ! En fait Crazy Thunder Road est mon film de fin d'études et il ne ressemble probablement à aucun long-métrage sorti auparavant au Japon. C'était aussi la première fois qu'un film indépendant était distribué et exploité par le réseau de la Toei. Son succès a été immense et on a alors beaucoup parlé de moi tout d'un coup. C'est certainement grâce à ce film que j'ai fait une carrière par la suite. J – A propos des influences, votre traitement des figures du marginal et du motard m'a évoqué le regard portés par Burroughs et le Gus Van Sant de Drugstore Cowboy sur le junkie, qu'en pensez vous ? Vous sentez vous proches de leurs visions et leurs productions respectives ? S – Je n'ai pas l'impression que mes films ressemblent à ceux de Gus Van Sant mais j'apprécie beaucoup son cinéma, en particulier My Private Idaho et Elephant. Cette comparaison est interessante mais je n'y avais jamais pensé. Comme ce sont des films que j'aime beaucoup, cela me fait bien évidemment plaisir. J – Parlons maintenant de Burst City. Le film est très impressionnant. Pouvez vous nous dire quelles sont les différentes versions existentes du film et ce que vous avez cherché à représenter avant tout ? Quel était votre sujet de départ ? Le punk ? Une forme de visions d'apocalypse ? S – En fait ce que vous avez vu à l'Etrange Festival est un montage spécial. La « vraie » version dure deux heures et a été réalisée pour la Toei un an après Crazy Thunder Road. C'est la première fois que j'ai travaillé sur un film dont la date de sortie était décidée avant le tournage. Certes, je bénéficiais alors de beaucoup plus de moyens qu'auparavant mais je n'avais pas la compétence nécéssaire pour finir le film en temps et en heure. La Toei m'a donc obligé à sortir un montage de deux heures mais inachevé. Pendant longtemps j'ai souhaité refaire ou au moins terminer ce film mais la Toei qui avait tout financé à l'époque n'a pas voulu m'écouter car les producteurs n'aimaient vraiment pas le film. Aujourd'hui, même pour un festival comme celui ci, la Toei refuse de prêter ou de louer une copie du film. Pourtant je veux vraiment montrer ce film. C'est pour cela que je remonte moi même des rushes que je possède et que je présente le film tel qu'il a été vu ici, c'est à dire en vidéo et sous forme de performance, avec une musique créée en direct. En réalité, Burst City a été tourné en 35 mm. J'ai tourné moi même toutes les images du film. Il y avait vraiment ce genre d'énergie tout autour de moi en 1981. Bien sûr je voulais qu'il y ait quelque chose d'apocalyptique dans ces images mais pour moi c'est avant tout une forme de document, malgré la fiction. Il s'agissait de représenter cette énergie qui était en nous et mes référents étaient très importants. J'avais le Cuirassé Potemkine en tête pendant le tournage. Aujourd'hui forcément, quand je revois Burst City j'ai un peu honte. A l'époque je n'avais par exemple aucune compétence pour le montage de mon film.C'est en réalisant ce film que j'ai pris conscience que l'énergie de mon cinéma était celle de quelqu'un qui n'y connaissait pas grand chose. Et en même temps, l'équipe du film s'est divisée lors du tournage car nous étions vraiment confrontés à nos limites. Je vois Burst City comme le dernier de mes films de débutant d'où mon attachement à son égard. Il reste à mes yeux un film éternellement inachévé. Il y a encore aujourd'hui des fanatiques de ce film auprès des amateurs de rock, mais à l'époque le film avait vraiment été detesté par les adultes et la maison de production. Ensuite j'ai pu tourner Crazy Family grâce à Hasegawa et après cela il m'a fallu dix ans pour pouvoir recommencer à travailler. J – Ce film, Crazy Family, est déjà assez différent des précédents.C'est le dernier qui s'inscrive dans une veine directement critique et satirique vis à vis de la société japonaise, et sa forme est bien loin de celle de Burst City ou Crazy Thunder Road. S – Après l'échec de Bust City, j'ai pris la décision de tourner mon film suivant de manière classique. Même s'il est satirique, mon film rentre dans une certaine tradition du cinéma nippon en revenant sur le famille japonaise moyenne. C'est un film indépendant dont le budget était réduit, d'où une certaine exigence en matière de qualités de scénario et de mise en scène. C'est la première fois que j'ai tourné un film en ayant conscience d'être réalisateur de cinéma. Pour cela je dois d'ailleurs beaucoup à Hasegawa. C'est le film qui m'a demandé le plus de temps dans son écriture et je pense avoir envie de refaire un jour un film de cette façon. D'Angel Dust à aujourd'hui, les films que j'ai faits ont été réalisés de manière presque expérimentale car à chaque fois, je cherchais un autre côté de mon moi. La prochaine étape de cette recherche passe par exemple par le film que je suis en train de préparer. Et dans mes prochaines oeuvres, j'ai bien l'intention de renforcer encore mes compétences en matière d'écriture de scénario et de mise en scène. J'ai plusieurs projets avortés qui coûtaient trop cher aux yeux des producteurs, j'espère en m'améliorant parvenir à convaincre ces derniers de les financer. J – Après Crazy Family vous avez mis 10 ans à tourner à nouveau. Pouvez vous nous dire pourquoi, ce que vous avez fait pendant ce temps et si vous avez ressenti la crise que connaissait le cinéma nippon à l'époque ? S – Vous vous doutez bien que pendant cette période, j'aurais aimé pouvoir réaliser de nouveaux films. Malheureusement j'ai senti à l'époque une baisse de l'estime des producteurs vis à vis de moi et puis comme vous le dites, il y avait la crise... Pourtant Crazy Family avait connu un certain succès au Japon et dans le monde : il avait été à Berlin, on l'avait distribué en France. Suite à ce film, j'ai meme reçu des propositions de producteurs étrangers, notamment d'Hollywood. Mais à l'époque je tenais à faire mes preuves au Japon et pas ailleurs. Malheureusement les producteurs et les critiques japonais avait peu d'estime pour mon cinéma. J'avais le projet d'un film que je désirais vraiment faire et que je croyais réalisable, ce pour quoi j'ai fait énormément d'efforts, en vain malheureusement. J'ai passé dix ans à proposer des projets les uns après les autres, refus après refus tandis que je « m'occupais » en réalisant pendant ce temps des films à partir des concerts de groupes de rock. La situation dans laquelle j'étais était très dure moralement et au bout de huit ans j'ai décidé de changer de manière de procéder. Comme il y avait plusieurs producteurs au Japon qui auraient éventuellement pu travailler avec moi, j'ai décidé de réfléchir avec eux à la manière de faire mon film. C'est comme ça que j'ai pu enfin refaire du cinéma et réaliser Angel Dust ainsi que les films suivants.
J – Puisque l'on en vient à ce film que l'on a pu revoir au festival, ce qui me frappe quand je le vois c'est les progrès étonnants que vous avez faits si on le compare à vos réalisations du début des années 80. Comment expliquez vous cette toute nouvelle maîtrise de la mise en scène qui de manière assez impressionnante surgit après vos dix ans d'absence ? S – Comme je vous le disais, à partir de Crazy Family, j'ai décidé de procéder en vrai réalisateur de cinéma. Comme je n'avais jamais étudié les possibilités du médium, je me suis beaucoup autoformé. Pendant mes 10 ans de silence, pour la première fois de ma vie j'ai vu beaucoup de films, j'ai voyagé en Europe et en Asie du Sud-Est. J'ai fait tout mon possible pour étudier le cinéma, réfléchir dessus et voir ce que j'étais capable de faire. Ainsi, j'ai découvert des parts de moi même que je ne connaissais pas et j'ai appris à faire de nouvelles formes de films. J'ai écris toutes sortes des scénario car je ne voulais plus faire des oeuvres aggressives comme l'étaient Crazy Family et la plupart de mes films précédents. A partir d'Angel Dust, j'ai toujours eu à la fois 5 ou 6 projets dont le scénario était déjà écrit et c'est au producteur que je demandais lequel il était prêt à financer. Jusqu'à Gojoe, j'ai toujours procédé ainsi et les producteurs ont choisi ce qu'ils voulaient parmi mes propositions. Aujourd'hui j'ai beaucoup plus de ressources qu'avant Angel Dust. Grâce aux progrès du digital je peux même maintenant bénéficier d'une importante liberté qui me permet une certaine efficacité pour peu que je me contente de faibles budgets. Aujourd'hui j'ai compris que j'étais capable de réaliser ce que je voulais du moment que je faisais les progrès nécéssaires en terme de mise en scène et d'écriture. Il ne s'agira jamais que de me donner les moyens de mes ambitions. J – Dans le Labyrinthe des Rêves que vous avez réalisé trois ans plus tard, en 1997, vous collaborez pour la première fois avec Asano Tadanobu à une époque où il n'était pas encore la super-star qu'il est aujourd'hui. Depuis vous avez signés trois autres films ensemble. Outre le fait qu'il recherche comme vous son inspiration dans la musique, quelles affinités, quel rapport avez vous avec cet acteur ? Et comment le situez vous dans votre travail ? S – C'est vrai qu'il y a la musique mais par ailleurs, nous avons vraiment les mêmes goûts à tous les niveaux. Même s'il est aujourd'hui extremement sollicité, j'ai le désir de retravailler avec lui pour des collaborations encore plus fructueuses. J'aimerais beaucoup être son auteur attitré et je vais tout faire pour lui trouver une place dans mes prochains films. J'espère simplement que de son côté il trouvera une place pour moi dans son emploi du temps car il reçoit à présent des solliciations du monde entier. J – Ce qui frappe dans tous les films que vous avez réalisés à partir d'Angel Dust, c'est le travail sur le son. A chaque fois, cette dimension de vos réalisations s'avère très impressionante, que l'on parle d'une musique assez proche de celles de vos début, quasiment bruitiste dans Electric Dragon, ou d'ambiances beaucoup plus calmes, avec des atmosphères assez travaillées à l'image de celle d'August in Water par exemple. Comment pensez vous et concevez vous cette partie de vos films ? S – En fait, je suis un grand admirateur des débuts du cinéma, le muet. Je n'aime pas du tout les dialogues. L'idéal pour moi serait de m'en passer. Mais ce serait trop « spécial » pour produite un tel film à l'heure actuel. J'envisage simplement de faire un jour ou l'autre un film qui évoquerait le cinéma des temps du muet. Je ne suis simplement pas sûr que les spectateurs accepteraient une telle tentative. J – On en arrive maintenant à Gojoe, un film très étonnant lui aussi, comment ce film vous est il venu ? Vous êtes vous soudainement dit un jour que vous vouliez réaliser un « chambara fantastique » ? S – Mes intentions étaient vraiment multiples. J'aurais aimé pouvoir tout mettre dans le film, mais cela coûte très cher et il est difficile de tout correler dans une seule et même oeuvre. En cela, Gojoe est un film très ambitieux. Je n'ai pas vraiment pensé au public étranger en le faisant. L'intrigue prend sa source dans une histoire très connue des Japonais, le duel le plus connu du Japon et sans doute aussi le plus mystérieux, personne ne sait comment cela s'est terminé. J'imagine que l'image qu'étrangers et Japonais ont du film est très différente. Mon intention était de faire un récit vieux de mille ans tout en restant profondément ancré dans des considérations qui relèvent du présent et de notre futur. J – Votre film suivant est Electric Dragon 80 000 V., encore un film avec Asano Tadanobu. Ce qui attire immédiatement l'attention dans ce film, c'est bien évidemment le rapport à la culture cyber-punk. Qu'est ce qui vous a amené à faire un film cyber-punk dix ans après l'apogée du mouvement ? S – Le mot cyber-punk vient des romans de l'américain William Gibson. Avant même de connaître ce type d'auteurs, j'avais réalisé des films comme Crazy Thunder Road et Burst City, donc des histoires à la fois punk, et d'anticipation de futurs proches. Dans Electric Dragon comme dans ces films, à ma façon, je voulais décrire un mode de vie quotidien, sous forme de conte en quelque sorte. C'est une manière très forte, riche en imaginaire, de raconter des histoires. Après mes premieres réalisations est apparu un film que j'aime beaucoup et qui m'a marqué : Blade Runner de Ridley Scott. C'est à cette époque qu'on a commencé à parler de cyber-punk. J'étais agréablement surpris de découvrir cette appellation et j'ai compris que certaines personnes réfléchissaient et créaient de la même façon que moi. Ce sont d'ailleurs ces gens qui m'ont contacté les premiers. J'ai même failli réaliser un film à Hollywood avec William Gibson juste après Crazy Thunder Road. En tout cas avec lui j'ai beaucoup appris et réfléchi. Je croyais qu'on travaillait inconsciemment sur le même genre de choses lui et moi, lui dans les romans, moi derrière ma caméra, et je pense même qu'il y avait à l'époque au Japon des groupes de rock qui étaient sur la même longueur d'onde. Evidemment je ne cherchais pas à produire « du cyberpunk ». C'est le produit de nos reflexions individuelles et communes qui est devenu le cyber-punk. J'ai fait un court métrage intitulé Ajia no Gyakushu qui est véritablement mon oeuvre la plus représentative de mon travail dans le mouvement. C'est ce film qui m'a valu d'être contacté par les acteurs du cyber-punk aux Etats-Unis. En fait quand j'ai tourné Electric Dragon, cela faisait longtemps que je n'avais plus touché au cyber-punk. Après Le Labyrinthe des rêves, j'avais un important projet de co-production avec l'Allemagne qui s'est écroulé à la veille du premier jour de tournage parce que nous n'avions plus le financement japonais que nous espérions. Cette expérience m'a vraiment démoralisé et un producteur que je connais bien et qui a aussi produit Gojoe m'a alors proposé de réaliser le projet que je souhaitais pour me relancer. J – Quel regard portez vous sur Tsukamoto Shynia dont le Tetsuo ressemble beaucoup à Electric Dragon ? S – Ce que j'admire plus que tout chez lui, c'est sa capacité à produire et financer lui même ses films. Il fait tout tout seul ce qui lui permet d'avoir une importante liberté. J'aimerais pouvoir en faire autant, mais je privilégie la possibilité de travailler avec une équipe technique complète, compétente et professionnelle (comme quand je collabore avec Asano) ce qui coûte cher. Cela dit peut être que sur Electric Dragon j'ai travaillé de la même façon que Tsukamoto d'une certaine manière. En fait je ne savais pas vraiment comment procéder au départ. Electric Dragon était déjà un projet risqué en lui même. J'ai dû le tourner en temps très limité (en réalité il a été tourné avant Gojoe, même s'il n'est sorti qu'après). Mon idée était de conter une histoire simple avec un fort symbolisme en mettant face à face un homme qui vit dans les quartiers chauds d'Asakusa et de Shinjuku dont la moitié du corps est un bouddha en métal et un homme-réptile, un homme-dragon qui vit dans une cave et évolue en se faufilant entre les immeubles, sans que personne ne le voit. En temps normal un producteur n'aurait jamais misé sur un tel scénario et un tel film. J - Pour finir, pouvez vous nous dire quelle place vous pensez avoir dans le cinéma japonais contemporain ? S – J'ai l'impression d'être vu comme un réalisateur très spécial. J'ai une position assez marginale. Je n'ai pas un public de cinéphiles, mais plutôt d'artistes, de musiciens, de plasticiens... Il ne viendrait pas à l'idée d'un journaliste japonais de venir m'interviewer. |
