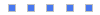
On peut d’ailleurs faire le parallèle entre votre statut d’artiste indépendant hors du « Star System » et vos personnages qui sont en marge du développement économique…
Nous sommes dans une société qui donne à penser que l’on trouve obligatoirement le bonheur à travers la richesse. A Taiwan, les hommes d’affaires sont en quelque sorte glorifiés et servent de modèle. J’estime pour ma part que le bonheur ne se trouve pas forcément dans ce développement économique effréné.
Mais je n’ai pas réussi à réunir les fonds suffisants pour tourner là-bas et j’ai abandonné mon projet, du moins jusqu’en 2005 où, dans le cadre du 250ème anniversaire de Mozart, on m’a proposé de réaliser un film. C’est comme ça que I don’t want to sleep alone est né.
J’imagine qu’après votre mésaventure à Taiwan, la décision de la Malaisie de censurer votre film parce qu’il montre le pays « sous un mauvais jour d’un point de vue racial, éthique et culturel » a du vous décevoir également…
Effectivement, la commission de censure malaise a, dès le départ, interdit la sortie du film en salles. Vous savez, ce genre de décisions est monnaie courante dans ce pays du fait notamment de sa culture religieuse très ancrée, et ne surprend plus personne. Mais j’ai décidé de pousser la commission, qui n’avait visiblement pas compris le film, à s’expliquer sur son choix. S’en est alors suivi un grand débat national dans la presse et parmi la population sur le pourquoi de cette censure. En quelque sorte, j’ai suscité le débat et j’en suis finalement ravi.
Après réflexion, la commission a accepté de sortir le film en salles (en mai normalement), mais amputé de 5 passages, pour la plupart liés au sexe : les 2 scènes de masturbation ont été retoquées, ainsi que la scène où Rawang masse Hsiao-kang blessé parce que, tenez-vous bien, les censeurs ont estimé que Lee Kang-Sheng était alors en érection ! (rires) Mais si on ampute ces scènes, le film perd forcément tout son sens. Alors tout ce cirque continue pour tenter de sortir en version intégrale…
C’est votre 8ème long métrage avec Lee Kang-sheng, votre acteur fétiche. Est-il concevable d’imaginer un jour un film de Tsai Ming-Liang sans LKS ?
Non, c’est impossible ! Jamais je ne ferai un film sans lui. Vous savez, travailler avec Lee Kang-sheng est aussi une contrainte que je me fixe volontairement. Il est en quelque sort ma base de travail, avec ses limites physiques et ses limites d’âge, c’est mon matériau de départ à partir duquel je peux commencer à créer. Et je pense d’ailleurs que si François Truffaut était encore en vie, il tournerait sans doute encore avec son acteur fétiche Jean-Pierre Léaud !
On connaît votre passion pour François Truffaut. Mais au sein du cinéma récent, pouvez-vous nous citer quelques films qui vous ont le plus marqué ?
Il est difficile à Taiwan de voir des films autres qu’américains. J’ai cependant apprécié récemment un cinéaste argentin qui avait tourné un film sur la mort… Je ne me rappelle plus de son nom, je crois qu’il n’a tourné que 2 films… (ndlr : euhh… avec toute la bonne volonté du monde, je vois pas trop là :-) )
Côté asiatique, je n’ai par contre pas d’affinités particulières pour qui que ce soit…
Sincères remerciements à Tsai Ming-Liang, Vincent Wang pour la traduction, ainsi que Van-Thuan Ly, Barbara Schweyer et Marie-Christine Fontaine pour l'organisation.
Pourquoi avez-vous choisi de situer votre film dans la Malaisie d’aujourd’hui ?
C’est la première fois que je tourne dans mon pays, en Malaisie. Au début des années 90, dans le cadre de son plan de développement économique, le gouvernement malais a fait venir des milliers de travailleurs étrangers pour ses projets de construction. Les fameuses tours jumelles Petronas, qui étaient alors les plus hautes du monde, datent de cette époque. Mais à la fin des années 90, l’Asie a connu une grave crise économique et financière. Du jour au lendemain, tous les travaux de construction ont été stoppés, et ces travailleurs immigrés se sont retrouvés sans emploi donc en situation illégale. Bon nombre d’entre eux sont devenus des travailleurs clandestins. Quand je suis retourné à Kuala Lumpur en 1999, j’ai senti un malaise dans la ville que je n’avais jamais éprouvé avant. Le Premier Ministre de l’époque, Mahathir avait destitué son vice-Premier Ministre Anwar et l’avait poursuivi en justice pour, entre autres, corruption et sodomie. Anwar a été condamné, et a passé plusieurs années en prison. Les partis d’opposition ont organisé d’immenses manifestations pour protester contre l’arrestation d’Anwar, et la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Dans ces années-là, il était impossible de ne pas remarquer le nombre de travailleurs étrangers qui traînaient dans Kuala Lumpur. Ils avaient été attirés par la croissance économique du milieu des années 90 et ont tout perdu, y compris leurs rêves, dans la débâcle qui a suivi.
C’est un film sur la précarité chez les travailleurs immigrés ?
J’ai l’impression de les comprendre. Comme eux, j’ai vécu et travaillé à l’étranger pendant plusieurs années. C’est ce qui m’a donné l’idée de faire un film sur ce sous-prolétariat. J’ai essayé de monter le film une première fois, mais je n’ai pas réussi à trouver les fonds pour le réaliser.
Pourquoi avoir choisi Kuala Lumpur plutôt que les régions rurales où vous avez grandi ?
Je suis né à Kuching. C’est une ville qui est certes plus petite et plus calme que Kuala Lumpur, mais pas au point de la qualifier de « rurale » ! Je trouve que c’est plus intéressant de situer l’histoire dans Kuala Lumpur, car cette ville attire non seulement des gens de toutes les parties de la Malaisie, mais aussi des gens de tous les pays. La population est donc extrêmement mélangée, et la Malaisie est un pays passionnant pour toute personne qui s’intéresse à la question des immigrés en situation d’extrême pauvreté. La Malaisie exporte également des travailleurs vers les pays plus développés comme Singapour et le Japon, tout en important des gens qui viennent de pays encore plus pauvres, comme l’Indonésie et le Bangladesh. D’ailleurs l’Indonésie est le pays qui a la plus forte proportion de nationaux à l’étranger. Ces gens abandonnent leurs racines et partent en quête d’une nouvelle identité.
Vous avez l’habitude de transposer vos personnages d’un film à l’autre, mais ici, les personnages joués par vos acteurs préférés, Lee Kang-Sheng et Chen Shiang-Chyi ne sont pas ceux que l’on a déjà vus…
Le concepteur de l’affiche, quand il a vu le film, m’a dit qu’il trouvait que le personnage de Hsiao Kang était tout droit sorti de La Rivière ! Mais vous avez raison, cette fois-ci, j’ai placé mes deux personnages principaux dans un univers d’exclus. Un univers où ils sont vraiment en bas de l’échelle sociale et dont ils connaissent mal la langue et la culture. C’est facile de voir qu’ils sont « étrangers », mais personne ne se demande jamais d’où ils viennent. Un des techniciens malais m’a demandé pourquoi je filmais ces gens-là et leur vie, alors que tout le monde s’en fiche. Je lui ai répondu que c’était parce que justement, ils ne sont pas invisibles. C’est important qu’on les remarque, qu’on fasse attention à eux !
Mais personne ne peut vous accuser d’être un réalisateur qui fait du réalisme social… D’ailleurs votre approche de ces personnages est très loin de tout ce qui se dit d’habitude sur le sujet…
L’exclusion sociale de cette sous-classe m’intéresse évidemment, mais je n’ai pas voulu faire un film sur le thème de la lutte des classes. Le seul personnage qui n’est pas pauvre, parce qu’elle est dans une situation où elle peut embaucher des gens, c’est la patronne du café, mais sa situation n’est pas non plus très facile, comme on le voit quand son fils essaie de vendre son appartement. Je ne voulais pas non plus me focaliser sur les différentes ethnies de la société malaise. Je suis revenu à mes symboles habituels pour raconter une histoire de façon métaphorique. Que les travailleurs immigrés pauvres perdent leur identité, c’est un fait, mais qui sait ? Leur situation difficile peut aussi les amener à une toute autre identité.
Est-ce qu’il y a quelque chose dans votre film qui évoque le scandale Anwar Ibrahim dans ce film ?
N’oubliez pas le matelas ! Pendant le procès d’Anwar, quand ils ont abordé la question du scandale sexuel, ils ont apporté un matelas. C’était la pièce à conviction, et ça a profondément marqué les esprits. J’aurais voulu utiliser un matelas à ressorts plus moderne, mais j’ai trouvé celui-ci, tout décati dans un motel une étoile, et c’était mieux ! C’est un gros matelas. Il est lourd, sale et il sent mauvais, mais pour quelqu’un de pauvre, c’est un trésor.
Vous ne précisez pas l’origine de Rawang, l’homme qui va prendre soin de Hsiao Kang et le remettre sur pieds.
Au moment de l’écriture du scénario, je le voyais indien ou bangladeshi, et on a auditionné des centaines d’Indiens et de Bangladeshi sans trouver celui qu’il fallait pour le rôle. Ensuite, je me suis souvenu d’un type que j’avais rencontré en faisant des courses dans un petit supermarché ouvert la nuit. Il vendait des pâtisseries cuites en friture sur les étals des marchés et avait l’air d’être un travailleur immigré. J’ai demandé à un assistant d’aller le voir. L’assistant m’a rappelé en me disant « Laisse tomber, c’est un Malais, pas un Indien, et il a les dents complètement abîmées ! » J’ai abandonné l’idée, mais j’ai continué à lui acheter ses gâteaux. Un jour on s’est mis à parler. Il m’a dit qu’il s’appelait Norman et qu’il venait de la campagne. Il avait grandi avec son père dans une immense forêt, il buvait l’eau à la source et mangeait les poissons de la rivière. De temps en temps, il croisait un tigre, mais n’avait jamais eu peur. A l’âge adulte, il est parti pour la ville dans l’espoir de trouver une vie nouvelle et il a vécu quelques années avec un groupe d’immigrés. Plus je discutais avec lui, plus j’avais envie qu’il joue dans mon film. Je lui ai raconté l’histoire dans les grandes lignes et il a parfaitement compris. Je lui ai fait faire un essai devant la caméra et il était complètement naturel, comme s’il n’y avait pas de caméra. Norman est musulman. Si j’avais trouvé un Indien comme je le voulais au départ, il y aurait eu des scènes de sexe entre lui et Hsiao Kang. Mais comme j’ai choisi Norman et que l’homosexualité est taboue chez les Musulmans, j’ai dû revoir ma copie et changer la relation entre les deux hommes.
Y a-t-il eu d’autres modifications dans le scénario ?
Il y a cinq ans, le thème du scénario, c’était effectivement les travailleurs immigrés en situation difficile. Je ne l’ai pas terminé à cette époque, et quand je l’ai repris, j’avais vraiment envie de parler de liberté. Nous avons tous une durée de vie limitée et un corps qui n’est pas éternel. Mais à quel moment sommes-nous vraiment libres ? La première scène que j’ai tournée, c’est celle où Norman couche Hsiao Kang et le lave. J’ai été touché en regardant les gestes simples et justes de Norman. Ca m’a fait comprendre quelque chose d’important ; que les petits gestes de la vie remplacent largement une intrigue sentimentale complexe. Du coup, j’ai décidé de simplifier au maximum mon scénario.
Le décor principal du film est ce bâtiment abandonné où dorment les sans-abri. C’est un lieu extraordinaire. L’avez-vous trouvé tel quel, ou avez-vous dû l’arranger un peu ?
Quand je suis venu à Kuala Lumpur en 1999, la construction de cet immeuble avait déjà été arrêtée. L’immeuble était barricadé et je n’ai pas pu voir l’intérieur. Quand je suis revenu à Kuala Lumpur pour commencer la pré-production, je me suis débrouillé pour voir l’intérieur, et ce sous-sol inondé m’a vraiment marqué. Et non, on n’a rien changé dans ce bâtiment. On l’a seulement éclairé.
Pourquoi la maladie est-elle toujours présente dans vos films ?
Si on comprend ce qu’est la vie, alors on ne peut pas en exclure la maladie. Les deux personnages joués par Lee Kang-Sheng sont malades. Il y en a un qui est en état végétatif, il n’ira jamais mieux. Et l’autre, c’est ce sans-abri que Rawang va ramener à la vie après cette agression qui l’a laissé pour mort. Dans le cas du deuxième personnage, qui pourrait bien n’être qu’un rêve dans l’esprit du premier, je voulais donner l’impression qu’il avance dans une sorte de tunnel. C’est comme une re-naissance, il revient à l’état du nouveau-né, soigné, lavé, nourri. Je trouve que le rapport entre deux personnes, entre celui qui s’occupe et prend soin de l’autre et celui qui reçoit cette attention, c’est ce qu’il y a de plus beau comme relation. C’est de l’amour inconditionnel. Et parallèlement, ça fait longtemps que notre poursuite aveugle du développement rend le monde « malade ». Cette brume de pollution qui tombe sur la ville en est un symptôme et elle n’arrive pas par hasard.
Les personnages que joue Lee Kang-Sheng dans vos films ne sont jamais très virils, du moins pas depuis Les Rebelles du dieu néon, mais ce SDF semble particulièrement passif. Pourquoi ?
Je trouve que Hsiao Kang ressemble beaucoup à ce grand papillon qui vient se poser sur son épaule. Il représente une certaine idée qu’on a de la liberté, une idée qui n’a pas vraiment d’existence dans le monde réel. Sa passivité n’est qu’une apparence, puisqu’à son contact, chacun des autres personnages se trouve. En prenant soin de Hsiao Kang, Norman va se trouver une identité et un rôle dans la vie. Quant à Chyi, c’est sa rencontre avec Hsiao et le désir qu’elle a pour lui qui lui fait prendre conscience de l’asservissement dans lequel elle vit. On a tous envie d’avoir quelqu’un à côté de soi quand on se couche. Et en arrière plan, je pense à ce proverbe chinois qui dit que lorsque deux poissons se retrouvent dans un ruisseau asséché, il faut qu’ils s’entraident.
