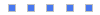
Cela fait désormais vingt-sept ans que la ville de Nantes organise
le festival des 3 Continents. Cette manifestation a pour objectif de faire
découvrir les productions cinématographiques d'Amérique
du Sud, d'Afrique et d'Asie. Comme chaque année le continent asiatique
occupait une place très importante dans la programmation du festival.
Nous avons eu l'occasion de revoir le très violent "Ichi the Killer" dans
une salle comble, au milieux d'un public de fan aquis d'avance.
Parmi les raretés inédites, il y avait, entre autre, un thrillers
thaïlandais. Pas vraiment un bon film, mais au moins un "document" intéressant
sur la dirrection que prend le cinéma populaire pour ados dans ce pays.
Enfin, le "retour aux origines" grace à la retrospective Cathay,
qui pour beaucoup fut l'occasion de découvrir les films qui ont bercé
l'enfance de réalisateurs comme Wong Kar-Wai ou Tsai Ming-Liang.
ICHI the killer
 Inutile de gloser des heures sur "ICHI the killer" (T.MIKE 2001)
tant sont nombreux, sur Cinémasie, les articles et les courriers de
lecteurs traitant de ce film explosif, pas le plus trash de Mike, mais l'un
des plus énigmatique et peut-être même selon moi (je ne
les ai pas tous vus) l'un des plus ambitieux. En plus de la valeur de mythe,
qui estampille la plupart des titres du réalisateur japonais, il est
quand même intéressant d'évoquer le personnage de gosse
battu au visage poupon de ce "justicier"traumatisé par son
enfance: ICHI.
Inutile de gloser des heures sur "ICHI the killer" (T.MIKE 2001)
tant sont nombreux, sur Cinémasie, les articles et les courriers de
lecteurs traitant de ce film explosif, pas le plus trash de Mike, mais l'un
des plus énigmatique et peut-être même selon moi (je ne
les ai pas tous vus) l'un des plus ambitieux. En plus de la valeur de mythe,
qui estampille la plupart des titres du réalisateur japonais, il est
quand même intéressant d'évoquer le personnage de gosse
battu au visage poupon de ce "justicier"traumatisé par son
enfance: ICHI.
C'est dans une tenue à la "Astro le petit robot" que notre
super héros passe à l'action pour extirper vésicules,
intestins, cervelles et repas de midi à ses victimes. On sait de quoi
T.Mike est capable en matière d'exposition organique… Ce qui
est surprenant chez ce personnage hyper violent et profondément débile
c'est l'hésitation qui précède chacune de ses manifestations
de violence.
Il est très rare de voire au cinéma un personnage qui porte à la
fois l'habit du justicier invincible et celui du psychopathe grave. On imagine
mal Batman, sujet à l'éjaculation spontanée au moment
où il s'apprête à venir en aide à une jeune femme
opprimée…
Autre curiosité qui donne à "Ichi the Killer" un intérêt
cinématographique, en dehors du simple balai sanguinolent, c'est le
rapport qu'entretiennent les personnages principaux avec la souffrance. La
douleur faite à l'autre n'est pas ici uniquement gratuite. Elle se transforme
peu à peu en une sorte d'échange typiquement humain voire de
témoignage amoureux dans lequel la mort est l'aboutissement le plus
sincère. Comme si l'ambiance de compétition extrême qui
règne dans l'archipel, celle qui amène les mômes à se
faire "ijimé" (phénomène de groupe qui consiste
dans les collèges à exclure un étudiant pour le persécuter)
ne permettait plus d'autres moyens de communication.
On peut donc voire dans "Ici the Killer", une critique de la société Japonaise.
En tout cas, c'est ce que se dira le spectateur qui, après avoir vu
et apprécié le film au-delà de son côté spectaculaire,
tentera de se rassurer. Pour les autres, ceux qui, dans la salle, hurlent (comme
ce fut le cas à Nantes) de satisfaction à chaque téton
découpé au cutter, ou à chaque viol de lycéenne,
je me dis que nous n'avons pas vu le même film ou que nous n'attendons
pas la même chose du cinéma.
L'art du diable
 C'est l'une des particularités des Trois Continents : offrir la possibilité de
voire des œuvres du monde choisi parmi les plus représentatives
de la production cinématographique de leur pays d'origine. Ce qui forcément
nous amène parfois à nous confronté à des langages
qui nous sont encore inconnus. À l'heure ou les salles consacrent une
partie de leur programmation aux "films étranger" (ce qui
le plus souvent veut dire: dire ni Français ni Américain), qui
répond de plus en plus à une attente du public Français,
il faut s'attendre à un phénomène inévitable de
formatage. Il est donc important parfois de rappeler que Jia Zhang-ke, Li Yang
ou Chen Kaige ne sont pas LE cinéma Chinois. En tout cas leurs films
ne sont en rien représentatif de la demande du public en Chine.
C'est l'une des particularités des Trois Continents : offrir la possibilité de
voire des œuvres du monde choisi parmi les plus représentatives
de la production cinématographique de leur pays d'origine. Ce qui forcément
nous amène parfois à nous confronté à des langages
qui nous sont encore inconnus. À l'heure ou les salles consacrent une
partie de leur programmation aux "films étranger" (ce qui
le plus souvent veut dire: dire ni Français ni Américain), qui
répond de plus en plus à une attente du public Français,
il faut s'attendre à un phénomène inévitable de
formatage. Il est donc important parfois de rappeler que Jia Zhang-ke, Li Yang
ou Chen Kaige ne sont pas LE cinéma Chinois. En tout cas leurs films
ne sont en rien représentatif de la demande du public en Chine.
De la même manière, le cinéma Thailandais ne s'illustre
pas uniquement au travers de deux réalisateurs opposés (les frères
Pang et A.Weerasethakul).
C'est donc en partageant cette ambition (celle de l'immersion non formatée)
et avec la ferme intention de voir un film qui, contrairement à celui
dont je viens de parler (Ichi the Killer), n'entrera jamais, sauf évolution
spectaculaire du public, dans la légende, que nous sommes allés
voir "L'art du diable" de Thanit Jitnukul.
Très populaire dans son pays, mais inconnu en France, Thanit Jitnukul,
est un cinéaste "touche à tout" qui s'est essayé à plusieurs
styles (comédie, drame, mélo, polar) avant de tourner ce thriller
fantastique dans lequel tout sent la précipitation.
Une caméra épaule, suit une jeune fille en larmes titubant au
milieu des longs couloirs d'une grande maison moderne. Elle découvre
dans l'une des chambres le cadavre de sa mère puis son jeune frère,
agonisant, le visage maculé de sang. On s'attend alors au traditionnel "coupez,
on la garde" pour interrompre la scène ; astuce un peu faiblarde,
pour nous engager sur une nouvelle histoire qui commencerait alors sur un tournage
de mauvais film d'horreur. Ce n'est pas très original, mais bon… Park
Chan Hook, Brian de Palma, l'ont fait eux aussi et ils ont eu largement de
quoi se faire pardonner entre temps. Mais là, rien! même pas cet
artifice hyper convenu. L'histoire délirante qui va suivre à déjà commencée.
On échappera alors à un nombre très réduit de cliché.
Flash-back pour expliquer le "Pourquoi j'ai tué tous les membres
de ta famille", justification (douteuse) d'ordre social du méchant
(qui d'ailleurs est une jeune femme), fantôme féminin (avec des
cheveux qui font peur), hôpital désert au moment où des
aspics investissent par milliers le corps d'un malade, et bien sûr l'incompréhension
des autorités qui ne voit rien de paranormal puisque cette force maléfique
n'est visible qu'aux yeux de ses victimes…
Dans la salle, malgré l'ambiance festive de spectateurs résolus à ne
pas prendre ce qu'il voyait au sérieux, on pouvait reconnaître
la qualité visuelle de certaine scènes. On pouvait céder
au frisson à condition d'apprécier les bonnes séquences
de manière individuelle, de ne pas trop penser à l'ensemble,
et de mettre de côté les enjeux dramatiques sensés nourrir
cette histoire écrite probablement trop vite.
"L'art du diable" à également, pour le public occidental,
l'intérêt de montrer un visage peu courant de la Thaïlande.
Une ambiance bourgeoise, moderne et High-Tech, constitue l'environnement des
personnages. Non pas que nous ignorions l'existence de cette classe sociale en
Thaïlande, mais l'habitude de voir des images qui se veulent authentiques,
représentant le pire comme le meilleur, ont forcé notre imaginaire à nous
représenter ce pays comme une surface de terre occuper exclusivement par
la jungle, la drogue, la prostitution et les bidonvilles.
Louons alors ce choix dans la programmation qui nous a permis de voir un film
Thaïlandais, sans exotisme, fait pour les Thaïlandais et non un "format" de
film qui répond à une attente du public occidental. Être
pris par surprise, voilà ce que l'on attend du cinéma, surtout
lors d'un festival comme les Trois Continents.
Cathay
Les fans de cinéma HK, qui se sont rendu à Nantes (ou qui s'y
trouvaient déjà car ils sont nombreux dans cette ville), ont
eu l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les films des studios
Cathay. Il est utile de rappeler que dans les années cinquante et soixante,
il n'y avait pas sur le petit territoire, uniquement les studios de la Shaw-Brothers
qui produisaient des films.
L'histoire de ces deux compagnie est intimement liée : toutes deux ont
commencé leurs activités en Malaisie au début des années
cinquante. Dans la plupart des grande villes du sud-est asiatique, lorsqu'un
cinéma projetait un film de la Shaw-Brothers, il y en avait un autre
en face qui montrait à ces spectateurs une production de la Cathay.
Toute deux ont réalisé plus de cent cinquante films en moins
de vingt ans, parmi lesquels on compte d'énorme succès.
À l'époque HongKong est, pour des raisons politique et économique,
certainement la région d'Asie la plus confortable pour réaliser
et produire des films. C'est là que Loke Wan Tho (le fondateur des studios
Cathay) concentre la majorité de son activité. C'est à ce
moment, au début des années cinquante, que s'engagera un climat
de compétition stimulant, propice à l'extraordinaire foisonnement
qui caractérise le cinéma hongkongais.
C'est dans la diversité des genres que la Cathay se démarque
de la Shaw-Brothers plus spécialisée dans le cinéma de
genre. La compagnie de Loke Wan Tho, produit des films de sabre, de kung-fu,
et des épopées historiques comme son rival, mais se risque également à proposer
au public des œuvres dont le ton et l'ambiance empruntent (parfois un
peu maladroitement) au style occidental. Ainsi, certaines comédies font
davantage penser, tantôt au comédie américaine ou italienne,
tantôt au cinéma du "New Deal".
Nous avons pu voir à Nantes, quatre longs-métrages de Wang Tianlin,
l'un des réalisateurs les plus populaires de l'époque. Autant
le dire tout de suite: si l'on peut reconnaître dans certains de ces
films ("Sauvage, sauvage est la rose", "Une fiancée pour
Papa"…), parfois l'influence de Franz Capra, une frivolité généreuse à la
Lubitsch, ou quelques beaux instants de comédie musicale, on a souvent
du mal à sortir de la "bien-pensance", du mélo paternaliste.
"La plus grande guerre civile du monde" (1961) est un concentré assez
significatif de tout ce Wang Tianlin pouvait produire comme munificence sirupeuse,
comme situations improbable qui n'ont d'autres mouvement que celui qui attire
inexorablement vers le happy end radical et sans compromis.
Deux tailleurs, l'un du sud, l'autre du nord, se mènent, l'un contre
l'autre, une guerre (d'où le titre) de voisinage qui finira par avoir
des conséquences désastreuses pour ce qu'ils ont de plus cher:
leur commerce. Dès leur première rencontre, ils se manifestent
une animosité féroce qui gagne en intensité lorsque le
hasard les amènent à vivre tous les deux, avec leurs familles,
dans le même appartement. Leur relation finie par ressembler à celle
d'un vieux couple qui s'engueule continuellement. Chaque déconvenue
de l'un, fait la joie de l'autre, et inversement. On observe alors une symétrie
parfaite entre ces deux personnage qui, malgré leur inimitié,
se ressemblent en tout point. Ils sont tous les deux gros, pratiquent la même
activité professionnelle, ont (si mes souvenirs sont bons) le même
nombre de filles et de garçons. Seulement voilà, l'un est du
nord et l'autre est du Sud.
 Heureusement, leur entourage finira par avoir raison de cette querelle en les
ramenant à la raison. La fille et le fils de l'un, projetant d'épouser
le fils et la fille de l'autre, le processus de réconciliation s'enclenche,
et s'engagent alors une suite de scénettes absurdes mais néanmoins
très drôles. C'est là que réside le charme naïf
des films de Wang Tianlin. Des sourires, des grimaces des guéguerres
qui n'iront pas bien loin et finalement des réconciliations.
Heureusement, leur entourage finira par avoir raison de cette querelle en les
ramenant à la raison. La fille et le fils de l'un, projetant d'épouser
le fils et la fille de l'autre, le processus de réconciliation s'enclenche,
et s'engagent alors une suite de scénettes absurdes mais néanmoins
très drôles. C'est là que réside le charme naïf
des films de Wang Tianlin. Des sourires, des grimaces des guéguerres
qui n'iront pas bien loin et finalement des réconciliations.
Dans le même style "Mambo girl" de,Yi Men fut un immense succès
lors de sa sortie en 1957. Là encore on retrouve les caractéristiques
d'une narration enfantine pleine de bon sentiments. Des histoires d'amours émaillées
d'inopportuns quiproquos souvent laborieux. Ce n'est pas le scénario
qui nous touche mais cet esprit de liberté gratuit et improbable.
Chang Grace (la star qui joue le rôle de Mambo Girl) danse bruyamment
avec ses amis malgré sa voisine qui menace d'appeler la police. La vie
semble faite d'anniversaire à fêter, de jeune filles à séduire
et parfois de problèmes familiaux à résoudre.
On sait pourtant que tout finira par s'arranger ; que tout le monde (même
la voisine) finira par rejoindre la joyeuse troupe d'étudiant pour danser
le Mambo triomphant.
On remarque alors, en tant que spectateur de 2005, l'absence d'évocation
politique, ce qui peut quand même semblé étrange dans une
région du monde comme HongKong, exposée à la proximité de
conflits explosifs. Mais cette absence (qui s'additionne à celle des
bisous sur la bouche) ne gène que le spectateur de 2005, que l'on doit
quitter pour céder à la magie.
