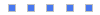
J’apprécie particulièrement Mendoza, La virtuosité de sa caméra, la vivacité et la spontanéité des images, et surtout la sincérité avec laquelle il aborde ses thèmes fétiches, font que je le considère comme le réalisateur asiatique le plus intéressant du moment. Je partage par ailleurs avec lui son analyse de la société, sa conception du monde.
Prenons Lola (3.75 / 5) : tout commence par un crime crapuleux, celui d’un type bien, honnête, bosseur, qui se fait voler son portable avant de se faire trucider au couteau par un type sans foi ni loi. Ce faisant, il ne peut bien sûr plus subvenir aux besoins de sa famille, modeste, qui vit dans un quartier déshérité de Manille le plus souvent inondé. Et les obsèques coûtent cher : cercueil, cérémonie, la grand-mère et l’épouse se saignent aux quatre veines pour trouver l’argent nécessaire, entre charité et aides sociales, pour honorer cet homme une dernière fois. Mais de quoi va vivre cette famille désormais ? Ruinée, sans salaire fixe qui rentre, l’avenir est sombre.
Heureusement, le meurtrier est arrêté. Un meurtrier qui semble se foutre comme de sa première chemise de son geste. La victime l’aurait soi-disant « insulté », et donc, selon lui, aurait mérité son sort. Prise de pitié, sa grand-mère va se démener pour lui : la loi philippine, très mal faite, permet à un juge de libérer un assassin si les 2 familles parviennent à s’entendre en amont (!). En gros, un crime s’achète. Ni plus, ni moins. Prime au riche. Ou au plus malin.
Se met alors en place un schéma aussi pervers que tragique : le crime engendre le malheur et la misère, et cette misère finit par engendrer l’injustice, donc l’impunité, donc la récidive, et ainsi de suite. Les conséquences sont cataclysmiques, comme semble le suggérer la dernière image qui élargit le champ à l'ensemble de la société. Cette analyse de la richesse et de la pauvreté des nations rejoint celle des plus grands spécialistes de la question, et va bien sûr à l’encontre total de la logique marxiste qui veut que les « injustices sociales » engendrent la misère, puis le crime. J’applaudis des 2 mains.
Le festival a également permis de découvrir les autres films de Mendoza, et notamment ses premiers, très peu diffusés. The masseur (2.25 / 5) n’est pas un grand film, mais il a le mérite d’aborder le délicat sujet de la prostitution masculine sous l’angle d’un masseur réalisant lentement qu’il se réduit lui-même à un morceau de barbaque, à l’image de son père mort séjournant temporairement à la morgue. On comprend alors mieux pourquoi le gérant du salon de massage peut vanter constamment le turnover de son cheptel à ses clients…
Quant à Manoro (1.5 / 5), il ne restera pas non plus dans les annales, la faute à une mise en scène proche de l’amateurisme, à du DV sale, à l’absence de raccords son, à de longues scènes répétitives de marche dans la brousse,etc… Pourtant, encore une fois, le thème abordé par Mendoza dans ce documentaire est loin d’être inintéressant et pourrait illustrer la fameuse phrase de Churchill : « Le meilleur argument contre la démocratie est une conversation de 5 minutes avec l'électeur moyen ».
On assiste en effet à la tentative touchante d’une jeune ado tout juste sortie de l’école d’apprendre le b-a ba de l’écriture et des modalités du vote présidentiel du lendemain à des populations rurales analphabètes des Philippines. Mais devant le peu de motivation générale et les explications désespérantes d’une mamie qui indique avoir voté pour 2 candidats à la fois parce qu’on lui a appris comme ça, la jeune fille perd espoir, et l’on se dit au mieux, qu’il y a encore du boulot pour faire prospérer la démocratie, et au pire, que la démocratie est loin d’être l’alfa et l’oméga de la gouvernance d’un pays : peut-on vraiment faire une confiance aveugle au choix d’électeurs qui ne maîtrisent pas les enjeux et qui sont incapables d’évaluer les conséquences de leur vote (et cela vaut dans tous les pays) ?
- Au revoir Taipei (3.5 / 5) : la comédie taïwanaise désormais habituelle du festival, comme toujours très bien sentie, drôle, tendre, et avec des méchants même pas méchants qui pointent sur la tempe avec des flingues en toc, qui s’habillent flashys et qui réclament même auprès de l'agent pour se rendre au poste de police le plus proche.
- Castaway on the moon (4 /5) : idée de départ vraiment excellente (faire vivre comme Robinson Crusoë un personnage au beau milieu d’une mégalopole tout en restant crédible, fallait le faire), comédie rythmée, bien interprétée et nous renvoyant tous aux tares de nos sociétés modernes (la robotisation de la vie sans supplément d’âme). A voir et à acheter en DVD. Ou le contraire.
- Sawasdee Bangkok (3.25 / 5) : bien sûr, 4 segments inégaux mais qui se tiennent, offrant 4 regards précieux sur cette ville complexe, à la fois belle et violente, qu’est Bangkok. Le dernier segment de Ratanaruang est une belle claque dans la figure pour toute cette génération de nouveaux riches des pays pauvres qui claque sa thune et roule des mécaniques, mais qui peut se faire remettre à sa place bien comme il faut par le dernier des clodos qui, lui, a gardé spontanéité, fraîcheur et générosité.
C’était donc quand même pas mal, cette sélection, finalement. Une moyenne de 2.91 / 5 pour moi, soit 0.3 poins de plus que 2009 et 0.23 points de plus que 2008. CQFD, y’a pas à dire, les maths y’a que ça de vrai. A l’année prochaine !
Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, il va bientôt arriver, l'ami festivalier ! Bon, jeudi matin, arrivé : 8h25, rien n'est ouvert, on ne peut même pas retirer les badges... obligé d'attendre comme un c*n devant le CID alors que ses moelleux canapés me font de l'œil et m'invite à finir ma nuit qui s'est terminée trop tôt... Après un coup de pression sur les vigiles planqués bien au chaud pour qu'ils ouvrent enfin et le précieux (mon précieux ! gnagnagna...) badge obtenu go to the Casino pour la première séance et le début d'une journée orientée philippine. Je débute par Manoro, un reportage au sein de l'ethnie Aeta sur les élections présidentielles réalisé par Brillante Mendoza.
Sur un sujet intéressant Mendoza tente trop souvent et parfois maladroitement de faire naître l'intérêt et l'empathie par un montage cinématographique évident et peu naturel. La multiplication des plans, les cadrages et la musique sur certaines séquences nuisent à la soit-disant spontanéité des émotions. La scène finale des larmes en pâtit directement, ne nous touchant pas du tout car faisant artificielle. C'est dommage car le fond est attrayant (la méconnaissance et l'indifférence de certaines populations pour la politique) mais la forme malhabile et la durée (autant regarder un reportage de France 5 de 25 minutes sur le sujet !) rendent le tout pataud.
Comme dirait quelqu'un dont je tairais le nom (en fait non : Martin), avec Masahita on est en présence d'un magnifique film de slips blancs. Une fois cette spécificité exposée et admise le métrage se laisse apprécier grâce à un bon travail de mise en scène et une musique s'accordant parfaitement aux images. Pareillement à d'autres de ses travaux (notamment Lola) Mendoza fait état du rapport à la mort des philippins et même si certaines scènes sont maladroites (les moments de tristesse du fils par exemple) la description du milieu des masseurs philippins, l'acceptation de leur métier (les masseurs ont des petites amies qui les autorisent à travailler, tant qu'ils ne touchent pas des femmes...) et leur quotidien sont retranscrits de manière juste et touchante.
Après le bon Masahita enchainement avec Tirador, la brillante (de Brillante, ah ah...) et bruyante descente dans les sous-sols et bidonvilles de Manille. Comme je l'avais déjà vu ici il y a deux ans j'en ai profité pour recharger les batteries en roupillant un peu. Mon voisin de siège de la journée en a fait de même, sauf que sa sieste fut beaucoup moins paisible que sur Le Masseur vu juste avant (oui, il a dormi sur les deux films...) : entre se faire réveiller par des hommes torse nu au ralenti et une jeune femme hurlant car elle a perdu son dentier dans le lavabo, forcément la sensation est différente :-).
 Tactical Unit - Comrades in Arms (2008)
: 4 /5
Tactical Unit - Comrades in Arms (2008)
: 4 /5
Cast Away On The Moon fait parti des bonnes surprises de ce cru 2010, c'est une excellente comédie sur une nolife et un pas de bol (entendez par là plaqué et viré). Le pitch accrocheur et original (un Seul au Monde au milieu du fleuve Han à Séoul) arrive à nous étonner et nous amuser, et malgré quelques facilités scénaristiques ainsi qu'une quinzaine de minutes en trop vers la fin le tout est vraiment agréable à suivre et drôle. On en demandait pas plus.
Pour Lola, dernier film en date de Mendoza, c'est simple : si vous êtes prêt à endurer presque 2h de grand-mères courages philippines qui se trimballent sous la pluie pour trouver de l'argent pour un enterrement et une sortie de prison, ce film est fait pour vous ! Et par extension pas pour moi... Bon ok il y a des jolis plans et sociologiquement Lola est intéressant, mais comme pour Manoro, un reportage de 25 min sur France 5 aurait été amplement suffisant...
 Pour terminer cette grosse première journée une bonne déception bien prétentieuse nous était proposée : Symbol. On assiste médusé pendant les trois quarts du film à un va et vient entre un homme coincé dans une pièce blanche où apparaît des objets lorsqu'il touche des quéquettes d'Ange présentes sur les murs et un avant / pendant / après match de catch au Mexique. L'humour de l'homme enfermé est essentiellement basé sur le gag de répétition, ici reproduit jusqu'à l'écœurement. Sur un sketch télévisuel de 10-15 min ça aurait été très efficace, pendant plus d'une heure, c'est autre chose... C'est dommage car par moment c'est vraiment drôle, mais voir un mec manger 10 sushis face caméra... un à un.... non, ça c'est relou. L'autre soucis c'est que plus on avance dans le film, et plus les séquences mexicaines sont espacées et raccourcies, alors que c'est elles qui nous permettent de tenir. Puis arrive ce final, d'une prétention inouïe qui mélange pèle-mêle Bush, une explosion nucléaire, une naissance, Obama, la nature, … Le comique, réalisateur, acteur Matsumoto Hitoshi se retrouve alors en look-alike Shoko Asahara (créateur de la secte Aum), les images balançaient font penser à un mauvais clip de recrutement et le tout devient franchement nauséabond. Si c'est du second degré, l'effet comique est raté, si c'est du premier, no comment...
Pour terminer cette grosse première journée une bonne déception bien prétentieuse nous était proposée : Symbol. On assiste médusé pendant les trois quarts du film à un va et vient entre un homme coincé dans une pièce blanche où apparaît des objets lorsqu'il touche des quéquettes d'Ange présentes sur les murs et un avant / pendant / après match de catch au Mexique. L'humour de l'homme enfermé est essentiellement basé sur le gag de répétition, ici reproduit jusqu'à l'écœurement. Sur un sketch télévisuel de 10-15 min ça aurait été très efficace, pendant plus d'une heure, c'est autre chose... C'est dommage car par moment c'est vraiment drôle, mais voir un mec manger 10 sushis face caméra... un à un.... non, ça c'est relou. L'autre soucis c'est que plus on avance dans le film, et plus les séquences mexicaines sont espacées et raccourcies, alors que c'est elles qui nous permettent de tenir. Puis arrive ce final, d'une prétention inouïe qui mélange pèle-mêle Bush, une explosion nucléaire, une naissance, Obama, la nature, … Le comique, réalisateur, acteur Matsumoto Hitoshi se retrouve alors en look-alike Shoko Asahara (créateur de la secte Aum), les images balançaient font penser à un mauvais clip de recrutement et le tout devient franchement nauséabond. Si c'est du second degré, l'effet comique est raté, si c'est du premier, no comment...
Démarrer le second jour par un film tadjik, en l'occurrence True Noon, paraissait hasardeux puisque le risque que ma nuit se prolonge dans la salle du Casino était important... mes craintes furent justifiées mais légèrement injustes car True Noon, même s'il n'est pas aussi bon que le film exotique de l'an dernier (le kirghiz Chant des mers du Sud), n'est pas non plus le truc hyper relou craint. Alors bien sûr le côté Borat ressort forcément et on a envie de bien rigoler quelquefois (tout en se sentant con, il est vrai) mais le premier degré humble et la résonance avec certains évènements récents (la Géorgie en l'occurrence) font mouches. C'est suffisant.
Après la simplicité de True Noon, l'enchainement avec la narration explosée (à ce niveau on ne peut plus dire morcelée...) de Paju fut assez rude à encaisser dans un premier temps. Si on ne fait que subir les événements qui se déroule à l'écran, on est perdu, forcément. En effet en fil conducteur on y suit la vie, sentimentale surtout, de Joong-shik (LEE Sun-kyun). Les séquences se suivent, ne sont pas toujours évidentes à situer malgré les indications temporelles et au milieu du film j'ai dû tout remettre en ordre dans ma tête afin de ne pas être largué. Une fois ce processus admis et appliqué, on se laisse prendre par les différentes relations et le fond social omniprésent (comme c'est souvent le cas dans les productions coréennes) apporte un plus, même si certains thèmes sont juste effleurés. À la fin tout devient limpide et on se dit que la structure du film est tout de même bien alambiquée (même si PARK Chan-ok dit qu'elle s'est créée de manière naturelle, voir l'interview - > pub pub) pour raconter une histoire somme toute simple et classique.
 Après la complexité de Paju, l'enchainement avec la narration simpliste (à ce niveau on ne peut plus dire linéaire...) de All to the Sea (ATTS) fut assez salvatrice à encaisser dans un premier temps (tiens, cette intro me dit quelque chose...). Les 20 ans de réalisation de dramas de la réalisatrice se font immédiatement sentir, on a l'impression d'en voir un sur grand écran. Yamada Akane n'arrive pas à s'affranchir des codes visuels et narratifs de ce type de productions. Le pire c'est qu'elle adapte l'un ses propres romans, et vu la tronche de l'histoire et des situations on se dit qu'en fait elle avait véritablement su trouver sa voie dans les productions télévisuelles. Durant la présentation du film, avant sa projection, elle nous avoue que son rêve c'était d'écrire des romans (chose qu'elle a faite) et de réaliser un long métrage... mais alors pourquoi donc ne l'a-t-elle pas fait (car ATTS est au mieux un téléfilm...) vu qu'elle en avait la possibilité ??! Bon ATTS possède quand même quelques ingrédients sympas comme son casting féminin ou parfois (pas tout le temps hein !) un second degré amusant. Et puis il y a également Sato Eriko qui est juste bombastique (bon ok ça fait parti du casting féminin...) seulement ce n'est pas suffisant, et lorsque un ado refoulé (Yagira Yuya) refuse de l'honorer alors qu'elle s'offre si généreusement à lui, c'en est trop ! La coupe (à défaut d'Eriko, désolé) est pleine ! Même si cette scène prouve que c'est une femme qui réalise (si c'était un homme derrière la caméra, je pense que le sort d'Eriko aurait été tout autre...) la bêtise, la misogynie et les clichés l'emportent. Je rends les armes et me fais prisonnier (et soumis, en espérant éventuellement être son esclave) à Sato Eriko...
Après la complexité de Paju, l'enchainement avec la narration simpliste (à ce niveau on ne peut plus dire linéaire...) de All to the Sea (ATTS) fut assez salvatrice à encaisser dans un premier temps (tiens, cette intro me dit quelque chose...). Les 20 ans de réalisation de dramas de la réalisatrice se font immédiatement sentir, on a l'impression d'en voir un sur grand écran. Yamada Akane n'arrive pas à s'affranchir des codes visuels et narratifs de ce type de productions. Le pire c'est qu'elle adapte l'un ses propres romans, et vu la tronche de l'histoire et des situations on se dit qu'en fait elle avait véritablement su trouver sa voie dans les productions télévisuelles. Durant la présentation du film, avant sa projection, elle nous avoue que son rêve c'était d'écrire des romans (chose qu'elle a faite) et de réaliser un long métrage... mais alors pourquoi donc ne l'a-t-elle pas fait (car ATTS est au mieux un téléfilm...) vu qu'elle en avait la possibilité ??! Bon ATTS possède quand même quelques ingrédients sympas comme son casting féminin ou parfois (pas tout le temps hein !) un second degré amusant. Et puis il y a également Sato Eriko qui est juste bombastique (bon ok ça fait parti du casting féminin...) seulement ce n'est pas suffisant, et lorsque un ado refoulé (Yagira Yuya) refuse de l'honorer alors qu'elle s'offre si généreusement à lui, c'en est trop ! La coupe (à défaut d'Eriko, désolé) est pleine ! Même si cette scène prouve que c'est une femme qui réalise (si c'était un homme derrière la caméra, je pense que le sort d'Eriko aurait été tout autre...) la bêtise, la misogynie et les clichés l'emportent. Je rends les armes et me fais prisonnier (et soumis, en espérant éventuellement être son esclave) à Sato Eriko...
City of Life and Death c'est la claque du festival, une monstrueuse taloche dans la tronche. C'est violent, révoltant, humaniste, guerrier, gerbant, déchirant, écœurant, choquant, touchant, et bien plus de mots se terminant par « ant » encore... Il faut juste le voir, et l'éprouver...
Ah oui, j'ai également vu 30 minutes de Judge. Bon ça avait l'air très important comme métrage... mais bon il y avait l'interview de PARK Chan-ok qui nous appelait. Chacun sa hiérarchie des priorités, surtout que vu comment le début était chiant, je n'ose imaginer la fin (en fait on me l'a raconté, ça m'a suffit !).
 Cette année, le prix du film d'action débile venant d'un pays qui n'a pas complètement digéré Fast and Furious et les plans frimes revient haut la main à Clash (après Born To Fight ou Nothing To Lose par exemple), actionner viet débile bien que se prenant très au sérieux. L'histoire prétexte (une femme veut récupérer sa fille des mains de son boss mafieux qui la retient en otage), complètement nase, est malheureusement trop présente. C'est fâcheux car les scènes d'action sont chiadées, lisibles, n'hésitant pas (à l'instar de certains Donnie Yen récents) à s'inspirer des prises du MMA (l'utilisation des genoux et des coudes, les différentes clés, …). L'actrice principale Veronica NGO est juste bombastique et contrairement aux reproches qui étaient formulés à l'encontre de Jee-ja YANIN les coups portent (grief qui me gênait, enfin bon), d'ailleurs par moment les protagonistes (quelque soit leur camp) sont de véritables punching-ball ! La musique oscille entre du hip-hop local embarrassant (sur l'intro hyper poseuse) et des envolées de musique classique juste infâmes à chaque présence du big boss. À noter l'apparition de bad-boys français musculeux et épilés complètement surréalistes malheureusement sous-exploités. Ces look-alike HPG tatannent sévères et on se demande ce qu'ils peuvent bien faire au Vietnam et se retrouver dans Clash ?? Comme scènes nanardes on peut citer l'arrivée tape à l'œil de la bande, avec travelling, ralenti / accéléré et tout le tintouin dans leur repère pour au final s'assoir sur … dans chaises perdues dans une baraque abandonnée... ou encore ce flic qui déboule en moto sans aucune raison dans un gunfight, quoique sa moto servira ensuite à l'un des méchants de s'enfuir, comme quoi elle avait son utilité... Ce qui est également amusant c'est de voir la volonté des scénaristes de trouver toujours un pays voisin pire que le sien, donc ici c'est le Cambodge qui est tout désigné. La pauvre héroïne y a donc été prostituée, si le film était khmer, ça aurait été le Laos, etc etc etc Au final dommage que LE Thanh Son ait été trop ambitieux en voulant développer une histoire digne de ce nom, car s'il s'était contenté d'aligner les scènes de frappes avec une intrigue prétexte ça nous aurait amplement comblé.
Cette année, le prix du film d'action débile venant d'un pays qui n'a pas complètement digéré Fast and Furious et les plans frimes revient haut la main à Clash (après Born To Fight ou Nothing To Lose par exemple), actionner viet débile bien que se prenant très au sérieux. L'histoire prétexte (une femme veut récupérer sa fille des mains de son boss mafieux qui la retient en otage), complètement nase, est malheureusement trop présente. C'est fâcheux car les scènes d'action sont chiadées, lisibles, n'hésitant pas (à l'instar de certains Donnie Yen récents) à s'inspirer des prises du MMA (l'utilisation des genoux et des coudes, les différentes clés, …). L'actrice principale Veronica NGO est juste bombastique et contrairement aux reproches qui étaient formulés à l'encontre de Jee-ja YANIN les coups portent (grief qui me gênait, enfin bon), d'ailleurs par moment les protagonistes (quelque soit leur camp) sont de véritables punching-ball ! La musique oscille entre du hip-hop local embarrassant (sur l'intro hyper poseuse) et des envolées de musique classique juste infâmes à chaque présence du big boss. À noter l'apparition de bad-boys français musculeux et épilés complètement surréalistes malheureusement sous-exploités. Ces look-alike HPG tatannent sévères et on se demande ce qu'ils peuvent bien faire au Vietnam et se retrouver dans Clash ?? Comme scènes nanardes on peut citer l'arrivée tape à l'œil de la bande, avec travelling, ralenti / accéléré et tout le tintouin dans leur repère pour au final s'assoir sur … dans chaises perdues dans une baraque abandonnée... ou encore ce flic qui déboule en moto sans aucune raison dans un gunfight, quoique sa moto servira ensuite à l'un des méchants de s'enfuir, comme quoi elle avait son utilité... Ce qui est également amusant c'est de voir la volonté des scénaristes de trouver toujours un pays voisin pire que le sien, donc ici c'est le Cambodge qui est tout désigné. La pauvre héroïne y a donc été prostituée, si le film était khmer, ça aurait été le Laos, etc etc etc Au final dommage que LE Thanh Son ait été trop ambitieux en voulant développer une histoire digne de ce nom, car s'il s'était contenté d'aligner les scènes de frappes avec une intrigue prétexte ça nous aurait amplement comblé.
Deuxième et dernier film de mon troisième jour de festival, The King of Jail Breaker fut une véritable déception... Après le boursoufflé Symbol j'espérais tomber sur un film japonais plus humble et vraiment rafraichissant, la contrariété n'en fut que plus grande. La première heure du film montre juste un mec qui se sauve, et qui se fait reprendre... tout le temps... Ok c'est marrant 5 minutes mais sur les 2/3 d'un film... Puis vient une délocalisation sur île prison, on se dit que ça va être un peu plus original, mais que dalle, ça reste toujours très mou, surtout que sur cette île un des geôliers est nain... source inépuisable de blagues de mauvais goût le potentiel comique de ce petit homme n'est jamais utilisé. Il y a aussi la psychologie du gardien de prison (Kunimura Jun) qui traque l'éternel évadé qui n'est pas du tout développée, ceci nuit à l'intérêt que l'on porte à ce personnage qui aurait pu être intéressant. Le film contient une vraie bonne idée, celle du tatouage (un mont Fuji retourné au milieu du torse), c'est peu. La scène finale sous forme de blague style tout ce que l'on vient d'assister n'est qu'une farce renforce l'impression d'inutilité du film... l'effet humoristique escompté provoque juste l'énervement. C'est raté.
Au revoir Taipei (2010) : 4,25 /5
 Au Revoir Taipei est LE film rafraichissant de Deauville 2010, une ambiance jazzy légère plane sur tout le métrage. Rien n'y est vraiment grave, les méchants ne sont pas vraiment méchants et les gentils plutôt neuneus. Les protagonistes sont attachants et l'ensemble du casting sonne juste. L'histoire se déroule seulement de nuit et Taipei est magnifiquement mise en valeur par un éclairage néon classique mais réussi. Le film dure à peine 1h30 et ça fait du bien de ne pas se taper 2 heures d'un film auteurisant taiwanais pompeux... ce qui n'empêche pas d'aborder des thèmes de société en filigrane (l'omniprésence des séries tv dans le quotidien ou encore la vitrine légal des triades). Aurevoir Taipei c'est bon, mangez-en :-)
Au Revoir Taipei est LE film rafraichissant de Deauville 2010, une ambiance jazzy légère plane sur tout le métrage. Rien n'y est vraiment grave, les méchants ne sont pas vraiment méchants et les gentils plutôt neuneus. Les protagonistes sont attachants et l'ensemble du casting sonne juste. L'histoire se déroule seulement de nuit et Taipei est magnifiquement mise en valeur par un éclairage néon classique mais réussi. Le film dure à peine 1h30 et ça fait du bien de ne pas se taper 2 heures d'un film auteurisant taiwanais pompeux... ce qui n'empêche pas d'aborder des thèmes de société en filigrane (l'omniprésence des séries tv dans le quotidien ou encore la vitrine légal des triades). Aurevoir Taipei c'est bon, mangez-en :-)
The Eternal (2009) : 1,5 /5
The Eternal est une bouleversante mise en abîme de la profession de foi de réalisateur. Bon ok j'en fait des tonnes, en fait remplacez « bouleversante » par « chiante » et là on est plus proche de la réalité. Le film est lent, trèèèès lent, les deux heures qu'il dure semble en paraître quatre... Rituparno GHOSH y décrit l'intégrité artistique de Aniket , réalisateur de son état. On y suit sa vie professionnelle et personnelle (plutôt tristounette cette dernière). Dommage que le film se concentre seulement sur ces 2 axes car d'autres sujets comme notamment la condition de la Femme en Inde aurait pu être largement plus explorés. En effet entre la femme cocue qui reste au foyer pour ne pas briser la carrière de son mari, l'actrice souhaitant percer qui visiblement couche avec chaque réalisateur qu'elle croise et la belle-fille caractérielle(mais que fait-elle avec cette endive de fiston tout mou ???) il y avait matière a ! De plus, tel un porno (ou plutôt par respect du genre, quoique), Rituparno GHOSH inclut deux scènes de chants, même si elle font moins parachutées qu'à l'accoutumée leur présence dans ce type de production auteurisante sonne toujours bizarre. Elles ont l'avantage de nous faire respirer au milieu des vicissitudes fatigantes des différents personnages. The Eternal démarre par une scène pompeuse, se termine comme un film sentencieux, la boucle est bouclée.
Sawasdee Bangkok est un projet omnibus de 4 courts métrages réalisés par SARTSANATIENG Wisit, ASSARAT Aditya, JATURANRASAMEE Kongdej et RATANARUANG Pen-ek.
Dans l'esprit on pourrait rapprocher le premier court de SARTSANATIENG Wisit d'un film de Brillante Mendoza en mode Lola, jugez plutôt : l'histoire s'intéresse à une jeune aveugle, qui vit sous un pont, dont la mère muette est morte, et qui avant de rencontrer un espèce d'ange est à deux doigts de se faire violer. N'en jetez plus la coupe est pleine. Il ne lui manquait qu'un chien cul de jatte et un poisson rouge atrophié et le tableau était complet ! De plus à Bangkok visiblement les non-voyants ne connaissent pas le principe de la fameuse canne blanche pour se déplacer, donc cette miséreuse, dès qu'elle tente de s'aventurer hors des lieux qu'elle connaît, avance à tatillon les mains en avant... mais bien sûr. Le dénouement qui montre un magnifique Bangkok dans l'imaginaire en contraste avec la dureté du quotidien relève à peine le niveau.
Bon le deuxième court de ASSARAT Aditya je n'ai strictement rien à dire dessus, dodo au début puis réveil à la fin. Honnêtement je ne me suis pas senti seul puisque mes voisins de sièges dont je tairais le nom (en fait non : Morgan, Xavier et Epikt) ont fait de même. Ceux qui n'ont pas roupillé l'ont trouvé très bien, tant pis j'essaierai de le voir à l'occasion.
Dans le troisième court de JATURANRASAMEE Kongdej on assiste à la rencontre et l'errance le temps d'un soir entre un homme de la campagne qui est monté à la Capital et une (très jolie) prostipute. Bien qu'imparfait on se laisse porter par ce segment dans Bangkok by night, parfois poétique, parfois romantique, souvent pathétique. Pour certains le twist est de trop, en effet il est assez maladroit et surtout facile, un peu à l'image du court finalement. Sa vision reste quand même agréable.
Le quatrième et dernier court était très attendu car réalisé par RATANARUANG Pen-ek, et celui-ci a tenu ses promesses. On suit la sortie de boîte de nuit de deux copines puis le retour chez elle de l'une d'elle. L'insouciance de cette jeunesse dorée est bien montrée, entre leur indifférence aux évènements politiques du pays (l'histoire se déroule en pleine opposition entre les « rouges » et les « jaunes », et leur seul soucis c'est d'éviter les bouchons que cela peut provoquer et de s'épargner d'être prises à partie à cause de la couleur de leur vêtements) et leur mépris envers les plus démunis (superbe deuxième moitié du court) rien ne les touche ou les intéresse. À ce titre la fin est vraiment poignante et Pen-ek réussit à nous emporter dans la tristesse et la gêne de cette jeunesse dédaigneuse. À noter le générique final carrément tripant où toute l'équipe de ce court se met à danser et chanter sur une zik de karaoké, Pan-ek en tête. Juste énorme.
Le premier moyen métrage de Chengdu, I love You est une romance futuriste martiale un peu nase bien que sincère dans sa démarche. Tout y est soit cheap, soit bancal, soit naïf. La musique comme l'aspect martial assurent mais tout ce qui est autour est d'une candeur confondante. La vision de ce segment n'est pas désagréable en soit, c'est déjà ça.
Le second moyen métrage présenté dans ce triptyque (dont on ne verra jamais le troisième segment...) est réalisé par Fruit Chan. Comme sur Sawasdee avec Pen-ek j'attendais donc forcément quelque chose de bien. Bon dans l'ensemble visuellement c'est assez réussi, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie. Les enjeux de ce qui se passent à l'écran ne touchent guère et en définitif on attend poliment le générique de fin.
En conclusion cette année 2010 fut vraiment sympathique, il y a avait un peu de tout : de la daube, du moyen, de la bonne surprise et du chef-d'œuvre. Dommage juste qu'on soit prévenu si tard de la programmation et des personnalités présentes, mais bon on y est habitué... Au passage je passe un p'tit wesh aux personnes que j'ai vues, revues ou découvertes lors de ce festival.
Que serait Deauville sans sa plage, ses planches, ses cabines de stars américaines et ses casinos ? Mais surtout, que serait Deauville sans ses festivals dédiés aux cinémas ? Cinéma au pluriel puisqu’en dehors de son célèbre festival du cinéma américain, la ville accueille depuis douze ans les cinématographies en provenance des quatre coins de l’Asie. Après un hommage à la Corée du sud l’année dernière, c’est la Chine qui est à l’honneur avec Lu Chuan, Lou Ye et plusieurs films de propagande réalisés à la fin des années 2000. Comme en 2007, place à un compte rendu sous forme de journal de bord !
Contrairement aux années précédentes, j’attaque le festival le jeudi, le lendemain de la cérémonie d’ouverture en présence de Brillante Mendoza venu alors présenter son dernier film en date, le beau Lola et ses portraits de grand-mères courages. J’ai également manqué les traditionnels petits fours du cocktail d’avant-cérémonie, mais j’avoue ne pas venir en festival pour me gaver de sushis et de champagne, les éternels sandwichs de Mamy Crêpe faisant toujours autant l’affaire pour tenir entre les projections. Malheureusement, première déception d’entrée de jeu : Purple Butterfly de Lou Ye est déprogrammé au profit d’Une Jeunesse chinoise, déjà présenté en France il y a trois ans. Je me tourne donc, en compagnie d’amis bloggeurs et de Junta, vers le cinquième et dernier Tactical Unit de la saga produite par la Milkyway et débuté par trois téléfilms. Réalisé par Law Wing-Cheong qui signe ici son sixième long métrage, Comrades in Arms revient sur les guéguerres au sein même de la PTU. Malheureusement si le film démarre par une efficace séquence de contrôle d’identité en ville, la suite en forêt déçoit par son manque de rythme et son action bien molle, avant de se clore sur un gunfight immobile pompant allègrement chez Johnnie To. Rien de plus normal lorsque l’on sait qui est à la production, on a même droit à la classique séquence du repas « en famille ». Il faudra bien les extrêmes maladresses d’un Lam Suet une fois de plus gourmand (le lancé de pneu, la fumigène…) et un karaoké sur un remix des Portes du pénitencier pour sauver le film de l’ennui : la mise en scène et la musique bien lourde nous rappelant que la saga Tactical Unit a été lancée à la télévision.


Mais pas le temps de se reposer puisque l’on enchaîne, toujours au Casino, avec la projection de l’excellent Cast Away on the Moon du coréen Lee Hae-Jun. Scénariste d’Antactic Journal, le cinéaste signe ici son second et fait preuve d’une superbe maîtrise. Un homme loupe son suicide et se retrouve sur une parcelle de terre en plein milieu du fleuve Han. Incapable de retourner en ville, il décide de jouer au Robinson Crusoé pour survivre. Du haut de sa fenêtre, une jeune hikikomori l’observe et décide d’entrer en contact avec ce dernier, comme à l’ancienne, en jetant des « bouteilles à la mer ». Original et très drôle sur le papier (l’homme échoue sur une île déserte entourée de buildings), le film étonne par sa superbe alchimie entre gags (l’homme redécouvre la vie en déféquant) et sensibilité grâce à la richesse de l’écriture des personnages. Celle de l’hikikomori est bien exploitée et donne lieu à des situations bien pensées : un help écrit sur le sable devient un hello, les deux personnages communiquent avec leurs propres moyens. Cette excellente surprise provient du fait que le cinéaste enchaîne les idées à un rythme soutenu, touche par son regard sensible et plein de justesse sur les personnages et la société coréenne (nouvelle vie loin de la ville, l’importance des nouilles), tout en soignant particulièrement sa mise en scène. Coup de cœur.
La journée se termine par l’hommage au chinois Lou Ye avec la projection de Nuits d'ivresse printanière, tourné clandestinement à Nankin, le cinéaste étant encore sous le coup d’une interdiction de tourner depuis Une Jeunesse chinoise. Œuvre soufflante sur les mésaventures sentimentales d’un couple, dont le mari, Wang Ping, s’éprend d’amour pour un autre homme en cachette. Sa femme le suspectant, elle engage un photographe pour le suivre et rapporter les clichés vérités. La situation va rapidement dégénérer puisque le photographe va à son tour tomber amoureux de l’homme fréquentant Wang Ping. Les deux hommes vont alors se fréquenter et la petite amie du photographe tombera elle aussi dans l’ivresse. Couramment ponctué de passages du livre éponyme, Nuits d’ivresse printanière rappelle combien Lou Ye sait filmer l’amour en pleine destruction, tout comme les pertes de repères. Vu comme ça, on sent le cliché. Pourtant, Lou Ye et sa caméra virevoltante s’affranchit de toutes les contraintes possibles et inimaginables. Son film fait preuve d’une liberté renversante, sidère par son caractère. Les séquences d’amour sont une nouvelle fois filmées de manière frontale, les errances rappellent Happy Together de Wong Kar-Wai, sa dernière demi heure est extraordinaire. La montée en puissance de l’amour sous toutes ses formes est ici caractérisée par un sentiment général de destruction, comme si l’épisode sulfureux n’allait durer qu’un temps, qu’une saison, qu’une nuit d’ivresse. Si Lou Ye aurait pu questionner davantage la difficulté de vivre librement son homosexualité en Chine, il semble préférer orienter son intrigue autour des rapports entre hommes et femmes, homosexuels ou non. Sa caméra s’attarde sur des lieux peu exposés dans le cinéma chinois, comme ces bars ou discothèques réservés aux homosexuels et aux transsexuels, navigue dans les couloirs d’une entreprise de produits contrefaits, dans un repère en montagne destiné à accueillir toutes sortes d’ébats amoureux, autant de lieux chargés en symbolique forte. On y reviendra à plusieurs reprises pour se rendre compte de l’état des sentiments, jusqu’à culminer dans un final entre déchéance et optimisme. Une chronique passionnelle pleine de force.


Pas évident d’en dire autant pour le Symbol du japonais Matsumoto Hitoshi projeté à 22h30 au Casino. Œuvre nonsensique par excellence et dénuée de véritables propos, elle est considérée par son dossier de presse enflammé comme une rencontre entre Cube et Dans la peau de John Malkovich. Le résultat se passerait presque de commentaires tant le film est un enchaînement d’idées qui, il faut bien le dire, ne font que très rarement mouche. Un homme se réveille un beau jour dans une immense pièce blanche sans porte ni fenêtres, bientôt recouverte de pénis d’anges qui occasionneront de drôles de phénomènes si notre héros à le malheur d’y toucher. En parallèle, un catcheur mexicain se prépare à monter sur le ring. Allez comprendre. Vous le comprendrez, d’ailleurs. Entre temps, le film aura réussi à ennuyer par son extrême répétitivité, ses gags pas souvent drôles et un Matsumoto Hitoshi en totale roue libre, hurlant, exultant, au fur et à mesure qu’il découvre la clé pour sortir de pareil environnement. D’ailleurs, ses idées pour s’enfuir sont représentées par des tutoriaux en forme de bande-dessinées absolument géniales. Mais malgré un concept hallucinant sur le papier, Matsumoto Hitoshi joue avec les formes et le poids des objets sans trouver de véritable chute à ce traquenard sournois. Fumage de moquette en forme de comédie passagère, Symbol se termine par un fly dont on aurait aimé plus de profondeur que ce nuage de stock-shots bien longuet avec 2001 dans le rétroviseur. Cruelle déception.
 En attaquant la journée avec Paju de la coréenne Park Chan-Ok, œuvre qui a déjà reçu les honneurs d’une critique presse encourageante et une sélection au Festival de Pusan (également l’un des financeurs du film) et de Rotterdam, dont il fit d’ailleurs l’ouverture, la journée s’annonçait de belle augure après l’échauffement de la veille parsemé de savoureuses éclaircies. Dans une Corée bien brumeuse, une jeune femme rentre d’un exil en Inde. Elle retrouve sur place l’ancien petit ami de sa sœur, aujourd’hui morte dans un tragique accident dont elle ne connait toujours pas l’identité du coupable. Malgré ses maladresses au niveau de la chronologie des évènements, rendant la narration plutôt difficile à mi-parcours, Paju est la preuve que les cinéastes féminines en Corée ont aussi leur fichu mot à dire. Park Chan-Ok réussit à évoquer les épisodes d’une vie de gens moyens de Paju, ville située au nord de la Corée du sud, à travers leurs expériences passées et présentes. Entre douloureux souvenirs et luttes pour garder l’immeuble dans lequel ils vivent, les personnages du film semblent être livrés à eux-mêmes. L’unité. Mais en parallèle, les deux personnages principaux du film (Joong-Shik et Eun-Mo) semblent à présent bien seuls. Si l’on aurait aimé avoir plus de précisions quant aux motifs liés à la religion et moins d’égarements au niveau de la narration, Paju est un travail sentant déjà la maturité : la mise en scène rigoureuse offre de beaux moments de cinéma (la sortie des camions de pompiers, le long plan filmant au ralenti une Eun-Mo de dos, nous faisant découvrir le lieu assiégé mais protégé par des jets de cocktails Molotov), en filigrane subsistent révoltes estudiantines, rapport nord-sud et les difficultés des populations expropriées. Comme ça, par touches. Mais le message est bien là. Un travail vraiment intéressant, suffisamment pour être un autre coup de cœur. Et n’allez pas dire que ceci est dû à la beauté de l’actrice Seo Woo, j’en serais mal à l’aise.
En attaquant la journée avec Paju de la coréenne Park Chan-Ok, œuvre qui a déjà reçu les honneurs d’une critique presse encourageante et une sélection au Festival de Pusan (également l’un des financeurs du film) et de Rotterdam, dont il fit d’ailleurs l’ouverture, la journée s’annonçait de belle augure après l’échauffement de la veille parsemé de savoureuses éclaircies. Dans une Corée bien brumeuse, une jeune femme rentre d’un exil en Inde. Elle retrouve sur place l’ancien petit ami de sa sœur, aujourd’hui morte dans un tragique accident dont elle ne connait toujours pas l’identité du coupable. Malgré ses maladresses au niveau de la chronologie des évènements, rendant la narration plutôt difficile à mi-parcours, Paju est la preuve que les cinéastes féminines en Corée ont aussi leur fichu mot à dire. Park Chan-Ok réussit à évoquer les épisodes d’une vie de gens moyens de Paju, ville située au nord de la Corée du sud, à travers leurs expériences passées et présentes. Entre douloureux souvenirs et luttes pour garder l’immeuble dans lequel ils vivent, les personnages du film semblent être livrés à eux-mêmes. L’unité. Mais en parallèle, les deux personnages principaux du film (Joong-Shik et Eun-Mo) semblent à présent bien seuls. Si l’on aurait aimé avoir plus de précisions quant aux motifs liés à la religion et moins d’égarements au niveau de la narration, Paju est un travail sentant déjà la maturité : la mise en scène rigoureuse offre de beaux moments de cinéma (la sortie des camions de pompiers, le long plan filmant au ralenti une Eun-Mo de dos, nous faisant découvrir le lieu assiégé mais protégé par des jets de cocktails Molotov), en filigrane subsistent révoltes estudiantines, rapport nord-sud et les difficultés des populations expropriées. Comme ça, par touches. Mais le message est bien là. Un travail vraiment intéressant, suffisamment pour être un autre coup de cœur. Et n’allez pas dire que ceci est dû à la beauté de l’actrice Seo Woo, j’en serais mal à l’aise.
Seconde projection de la journée, sur laquelle je ne m’étendrai pas étant donné que j’ai dû écourter la séance pour une interview (Park Chan-Ok, tiens). Malgré les sièges confortables du CID de Deauville, très peu de conditions étaient réunies : digestion d’un casse-croûte hypocalorique de chez Mamy Crêpe, nuit bien courte, film chinois sentant vaguement le déjà-vu ailleurs, plastique même pas intéressante malgré la belle HD. Non, Judge de Liu Jie n’est clairement pas le véritable Lotus d’Or de cette année, toujours dans l’attente d’un acheteur français. Que Syndromes and a Century paraît loin. Le film égraine les poncifs du « cinéma chinois auteuriste » et n’a même pas le sens du cadre ou de l’émotion d’un Jia Zhang-Ke, Wang Chao ou Diao Yi-Nan. On retrouve cette lourdeur symptomatique d’un certain cinéma meurtri, enchaîné jusqu’au coup, prêt à recevoir le couperet. Déjà-vu et en moins bien tout compte fait. Tout à fait autre chose, l’outsider All to the Sea de la réalisatrice Yamada Akane (on y perd au change face à Yoji) débarque juste après.
« All to the sea est mon premier film. Je travaille en tant que réalisatrice d’émissions de télévisions depuis plus de vingt ans au Japon, et j’ai travaillé sur des séries et documentaires. Depuis mon enfance, j’ai toujours rêvé d’écrire des romans et réaliser des films. J’ai commencé à écrire des romans pendant que je travaillais à la télévision en 2004, et j’ai publié à ce jour huit romans au Japon. Certains ont d’ailleurs été traduits en coréen. En accomplissant ainsi un de mes rêves, j’ai décidé d’en accomplir un deuxième, c’est à dire de tourner des films. Ce n’est d’ailleurs pas facile d’être une réalisatrice au Japon, et c’est grâce à mon parcours à la télévision que j’ai pu tourner mon premier film. All to the Sea est l’adaptation d’un de mes romans et son titre signifie que l’homme retourne à la mer, une symbolique de sa mortalité. J’ai essayé d’exprimer qu’il n’était pas utile de se précipiter vers la mort malgré toutes les expériences douloureuses que l’on peut endurer. Cela m’arrive en effet de ne pas me sentir bien. J’espère qu’il pourra donner un peu de courage aux spectateurs ». Malgré toute la bonne volonté de la cinéaste, force est de constater que le côté sirupeux de son discours face aux photographes et à la télévision japonaise venue suivre les pérégrinations de la cinéaste en France (coup de pub assez formidable, manquerait plus qu’une Tour Eiffel sur la jaquette du dvd) est hélas un avant goût du triste spectacle qui s’annonce. Malgré la présence de l’actrice Sato Eriko qui, avouons le, est juste méga bonne, All to the Sea est le genre de film lissé et tellement sucré qu’il n’a que pour ambition d’émouvoir les petits jeunes tokyoïtes fans de dramas. Film trop aseptisé et inoffensif pour attendrir, l’ensemble pêche par une écriture extrêmement stricte, enfermée dans sa bulle de conte de fées confectionnée par des saintes nitouches de première : au diable le moindre petit coup déplacé –une scène d’amour, au hasard- et ressors scénaristiques téléphonés à la pelle. Heureusement que son intermède comique, sur les aventures amoureuses d’une japonaise exilée aux quatre coins du globe, apporte ce petit vent de fraicheur bien venu dans ce ciel bien triste.


Il fallait attendre les coups de 19h30, après une pause sandwich bien méritée, pour assister au plus beau film du festival, City of Life and Death. Etrange me direz-vous, pour un film de guerre fleuretant très souvent avec l’insoutenable. En plein cœur de Nankin au cours de sa prise par l’armée japonaise en 1937, nous suivons les soldats japonais et résistants chinois dans ce que l’on pourrait appeler un véritable génocide. Dans son introduction, les chants de théâtre Kabuki se font entendre avant le premier affrontement, la caméra capte les visages au plus prêt, rappelant le cinéma soviétique d’avant-guerre, le massacre peut débuter. On rassemble les corps des résistants chinois comme du bétail avant de les massacrer à coup de rafales de balles, ou bien on les enterre vivant avant de danser sur le tas comme pour célébrer une fête. Avant quoi, « la Chine ne mourra pas » est hurlé par un résistant anonyme, puis repris par la foule. Il n’y a pas un seul héros dans City of Life and Death, l’héros est un groupe résistant. Et tandis qu’une importante personnalité nazie établit avec l’aide d’américains un camp sécurisé en accord avec l’armée japonaise –ici soudoyée-, les femmes sont violées, jetées par les fenêtres. L’humain n’a plus d’importance lorsqu’il ne sert que d’objet de réconfort. Le chantage du sexe contre des provisions devient alors un commerce courant. Lu Chuan filme alors les atrocités les plus abominables en passant très peu par la case hors champ, comme pour rappeler ce qu’est la guerre, ce qu’elle engendre.


Et si les soldats japonais sont montrés comme des êtres haïssables, Lu Chuan prend aussi le temps de les montrer sous un jour différent : les bourreaux d’un jour s’amusent, chantent, rigolent comme n’importe quel être humain. Pourtant, il n’est pas rare de les voir commettre des atrocités le temps d’un raccord. C’est toute la particularité du film, cette mixture improbable entre séquences de barbarie et d’autres bien plus humaines lorsqu’elles ne sont pas humanistes, allant jusqu’à traiter un soldat japonais avec empathie, l’un des seuls à avoir une conscience. Le secrétaire du « protecteur nazi » est un autre exemple, bien qu’il n’hésitera pas à signer un accord avec les japonais, visant à prostituer ses compatriotes chinoises pour sauver la vie de sa famille et, qui sait, celle de ses frères et sœurs. Qu’aurions nous fait à sa place ? Lu Chuan nous pose là, face à cette responsabilité. Mais City of Life and Death est un chef d’œuvre. Un film qui prend aux trippes 2h15 durant sans nous lâcher une seule seconde, étalant sa maestria formelle, ses images et propos absolument bouleversants, entre barbarie absolue et optimisme en guise de rayon de soleil final. Un terrible objet cinématographique, ponctué de morceaux de bravoure et de moments de cinéma proprement immenses (les mains levées des futures femmes de réconfort, le sacrifice et la parade en fin de métrage parmi tant d’autres). Il est néanmoins difficile de tout résumer tant City of Life and Death regorge de moments marquants.
A ce stade là ce n’est même pas une surprise, c’est une révélation définitive, qui devra se contenter prochainement d’une simple sortie dvd. Triste. A noter qu’il aura fallu 6 mois à l’équipe du film pour valider le scénario auprès des autorités chinoises, et six mois supplémentaires pour approuver le film terminé. Chaud les marrons.
Un mot avant de débuter. Cette année, le Morny est de retour. Une bonne nouvelle ? Oui et non dans la mesure où il semblerait que seule la petite salle à l’étage ait été réservée pour l’occasion, ce qui occasionna, comme hier soir pour The Sword With No Name, des séances affichant rapidement complet. Remarque, je n’avais pas réellement la tête à aller voir quoi que ce soit après l’ébouriffant City of Life and Death, une expérience à vivre définitivement en salles. Metropolitan ne semble pas le voir de ce même œil. Qu’importe. La journée du samedi débute donc avec l’actioner Clash du vietnamien LÊ Thanh Son, starring Johnnie Nguyen. Pur film de frimeurs rêvant d’Hollywood sans en avoir les moyens (les 4x4 de luxes sont ici remplacés par des mobylettes), déversant sa masse nanardesque sur le visage du spectateur à la fois ravi du spectacle régressif et des sérieux atouts des acteurs. Pour les mâles, Veronica Ngô irradie l’écran par sa plastique et ses méchants coups de tatanes. Pour les demoiselles, Johnnie Nguyen en mode Jason Statham, lunettes d’aviateur fumées et coups de genoux voltigés. Face à leur bande, dont certains portent du G-star, du français bodybuildés torse-nus adeptes du free fight (hélas mal utilisés), des gangsters en costard et des flics en mobylettes trop classes. L’introduction speedée et à la bande son agressive ravira les amateurs de bon vieux hip hop Viêt saturé. Loin d’être un grand film à cause de sa montagne de poncifs, Clash reste un vrai moment de rigolade, tombant dans la guimauve lorsqu’il le faut, agaçant lorsqu’il cause trop, mais toujours rattrapé par ses séquences de bagarre lisibles et fracassantes.


Deuxième film de la journée, The King of Jail Breakers du japonais Itao Itsuji, acteur de base qui signe son premier long métrage. Si l’idée de base est intéressante (un prisonnier réussit à s’échapper des prisons où il est incarcéré), le film s’avère être un pseudo essai loin, très loin d’être concluant. Alourdi par son extrême répétitivité pendant une bonne heure malgré de rares moments plutôt drôles (lors d’une scène où il vient d’être incarcéré, le détenu s’échappe dans la minute), le film ne semble vivre que pour son idée de base. Aucun sens du rythme, accumulation hallucinante de fondus enchaînés sans transition, l’homme élastique muet interprété par Itao Itsuji ne suffit pas à sauver le film de l’ennui le plus total avant de sombrer dans un final des plus grotesques, entre ironie, gag pas drôle et poésie aérienne. Comment peut-on tomber dans le panneau et adhérer à pareilles solutions narratives pas plus dignes d’un drama de base ? D’habitude excellent, Kunimura Jun en chef de police semble roupiller tout du long. La faute à une écriture des personnages manquant de relief et de cohérence, une intrigue truffée de rebondissements souvent identiques et ne suscitant aucune émotion particulière. L’enfance du prisonnier aurait pu donner plus de souffle au film mais son conclusion sombre dans le n’importe quoi. La séquence très ninja du début était pourtant prometteuse, The King of Jail Breakers préfère s’enliser dans un schéma répétitif agaçant et finir à côté de la plaque. Un film qui n’a rien à faire en compétition officielle.
Soutenu par Wim Wenders, Au Revoir Taipei du jeune cinéaste Arvin Chen (de nationalité américaine) remonte clairement le niveau. D’une remarquable fraicheur, groovy, jazzy et mignon comme tout, cette ballade un peu folle dans les rues de Taipei rappellerait presque le travail d’un Jarmusch sur Mystery Train : des jeunes paumés, des gangsters maladroits (joués par des adolescents) et un fond de romance adolescente tout ce qu’il y a de plus agréable. Arvin Chen a réussi a faire des quelques recoins de Taipei un petit monde à part entière avec ses néons colorés, ses gangsters ados en costume fluo roulant dans un gros jouet pourpre, ses méchants qui ne le sont pas vraiment et qui entraînent quelques moments de franche rigolade, tout est là pour passer un excellent moment intelligent, sensible et parfois même émouvant, récompensé ici d’un Prix du Jury mérité. En s’accaparant les codes du polar et en jouant autour des clichés du cinéma romantique, du genre craquant parce que fait de non dits typiques des romances taïwanaises, Au Revoir Taipei est l’une des bonnes surprises du festival. L’interdiction de courir dans le métro ou encore la partie de Mah-jong entre un kidnappé et ses ravisseurs ne manqueront pas de provoquer de sacrés rires. De plus, le film reste maîtrisé sur le plan formel, avec une bonne utilisation des ralentis (surtout sur la danse de fin) et un sens du cadre évident. De là à crier à la maturité, sans doute pas, mais Arvin Chen, qui a commencé à faire ses armes auprès d'Edward Yang, est déjà un cinéaste prometteur.


Difficile d’en dire autant pour Ciu Jian, jeune cinéaste mais rockeur confirmé et aimé des jeunes chinois. Pour le compte du film à segments Chengdu, I Love You, celui-ci endosse le rôle de réalisateur et signe une drôle de fable sur l’amour et un art-martial particulier. Plongé dans une espèce de sphère sonore rappelant la techno de Lim Gong et les sons assourdissants d’un Shimizu Koichi, le segment pêche par certaines de ses idées ridicules (la bague magique) ou inabouties (les marches arrières en fin de métrage). Cependant, la confrontation entre l’univers quasi tribal des danses de la jeune femme amoureuse et l’année à laquelle se déroule l’intrigue est un point intéressant. Ceci dit, en dehors des vélos futuristes, des tables de mixage ultra modernes ou des tenues sortant de l’ordinaire, difficile de se sentir dans un futur pas encore tout à fait proche. Reste une romance quelque peu haineuse pour trouver un peu de sens à cet étrange exercice de style, dont le tremblement de terre aperçu entre deux scènes rappelle la catastrophe du Sichuan. Qui dit film à segments, dit autre réalisateur. Aux oubliettes le coréen Hur Jin-Ho, qui fera de son segment un long métrage à part intitulé Season of Good Rain, toujours avec Jung Woo-Sung et Gao Yuanyuan. Reste donc Fruit Chan et son segment joliment rétro, sans grand intérêt. A la limite de se regarder filmer, le cinéaste inscrit son segment dans une veine plus comique, plus aventurière alors que l’action est proche de celle d’un huit-clos. La séquence des grenouilles ou les démonstrations du service du thé sont dignes d’un numéro de cirque. Les fans hardcore du cinéaste pourront toujours combler leur petit vide à ce niveau, les autres iront sûrement voir ailleurs. Mais avant de passer au dernier film de la soirée, le nazebroque Bad Blood de Dennis Law, j’aimerais revenir sur un point qui m’a chagriné. Je n’en étais pas à sortir les mouchoirs, mais le festival n’a clairement fait aucun effort pour se procurer une copie potable du film. La copie présentée n’était même pas digne d’un divx pirate et la bande-son était constamment étouffée par un souffle particulièrement puissant. Ca la fout mal pour une projection au C.I.D.
Heureusement les hostilités ont repris pas loin de là, au Morny, avec la projection en vosta (la petite salle n’étant pas équipée pour projeter un double sous-titrage) de la dernière purge de Dennis Law qui aurait très bien pu s’appeler Fatal Blood, après un Fatal Move et un Fatal Contact de triste mémoire. Qui pour succéder à la mort du parrain ? Voilà tout l’enjeu de Bad Blood, scénarisé par Dennis Law et photographié par Herman Yau. N’importe quoi agressif mais finalement très superficiel, faux film de triades mais vrai exutoire cheap, on pourrait continuer sur les adjectifs des extrêmes. Définitivement, Bad Blood vaut pour ses combats de mêlée bien bourrins mettant en scène la jeune Jiang Luxia, un garçon manqué muet doté de sacrées compétences martiales rappelant, attention à cette énorme facilité, Jackie Chan. En dehors des « un contre cent », Dennis Law est incapable de diriger correctement ses acteurs. Il nous ressort Bernice Liu du placard et lui offre le rôle de peste chic finalement imbattable lorsqu’il est question de lever la jambe. Désolé ça ne prend pas, surtout lorsque cette dernière démontre –lorsqu’elle n’est pas doublée- de bien tristes enchaînements. Par contre, aucun problème pour dézinguer du japonais, du black et du thaï dans une séquence qui ferait passer la mise en scène de Charlie’s Angels pour du Sokurov. En dehors de ses scènes de combat pas toujours très justifiées et ses personnages principaux tous lapidés un par un, Bad Blood reste un divertissement à voir entre potes autour de quelques bières, contenant son lot de rebondissements d’un triste mauvais goût. Même pas du niveau d’un Cat III malgré THE séquence où une grand-mère ligotée dans une voiture, priant son bourreau de l’épargner, finira tout simplement calcinée. Ca valait bien un minimum le déplacement même si la copie présentée était accompagnée d’un doublage mandarin à mourir de rire et que Simon Yam n’est pas crédible en combattant tout comme Lam Suet en costard. Ah, il faudrait aussi qu’ils arrêtent d’adapter les prénoms mandarins en anglais ; les Dumby, Calf, Bobo ou encore Funky sont juste à côté de la plaque. Mais c’est drôle.
Il est parfois intéressant de jouer aux pronostics. Avant d’entamer la dernière journée du festival avec la projection de My Daughter, premier long métrage de Charlotte Lim qui a fait ses armes chez TSAI Ming-Liang, Ang LEE ou encore James LEE. Non pas que je garde un grand souvenir de ce cinéaste, c’est juste que je sens venir, mes camarades également, le film auteuriste par excellence. Mais le film auteuriste qui n’a rien à dire, ou si peu. Évoquer le quotidien désespérant d’une mère et sa fille, du genre « on se sert les coudes ma fille » aurait pu donner de belles choses. Malheureusement elles ne se parlent pas, la fille rappelle à sa mère qu’elle est considérée en ville comme une trainée, les deux vomissent dans leur coin. Immobilité, froideur, débris. Mais on met du sucre sur ses tartines beurrées le matin pour éviter le coup de barre. Manque de pot, le coup de barre, elles l’auront tout du long. Si j’avoue être parfois client des films muets et des jolies filles qui font la moue, My Daughter plombe le moral par sa noirceur voulue. Une noirceur en tant qu’ambitions visuelles (le camion, le coup des essuie-glaces) et narratives (cette vague idée de suicide) récompensée par la critique internationale qui a sûrement dû voir « la richesse d’une cinématographie méconnue qui mérite toute notre attention ».


Mais ce n’est pas tout, si My Daughter questionnait…non, en fait il ne questionne rien, The Eternal de l’indien Rituparno Ghosh questionne quant à lui le cinéma d’auteur. C'est-à-dire ces films vus par les intellectuels et les cinéastes. Moi qui voulais un bon gros Bollywood qui tache sur grand écran, je pouvais encore attendre longtemps. Passé ses trois premiers quarts d’heure, une danse, exultation tellement qu’elle est simple, joliment chantée et mise en scène. Trois petites minutes de légèreté et d’émotion dans un océan de réflexions, de prises de bec, de larmes qu’on peine à retenir et de regards fuyants face aux problèmes. On n’aime pas se regarder quand ça ne va pas, surtout Jisshu Sengupta qui pour le coup use de ses yeux de cocker pour nous toucher. Mais non. Ne me sentant jamais concerné par ce qui se disait, j’ai préféré lâcher avant la fin pour discuter AV avec mon voisin de droite, Junta. Ce n’était certes pas le lieu, mais tout de même.
Sous un impeccable soleil, contrastant drôlement avec la grisaille cinématographique du matin, on quitte le C.I.D pour une pause pizzeria bien méritée. Rien de mieux avant d’attaquer l’omnibus thaïlandais Sawasdee Bangkok, dont les quatre segments sont réalisés dans l’ordre par Wisit Sasanatieng (Sightseeing), Aditya Assarat (Bangkok Blues), Kongdej Jaturanrasmee (Pi Makham) et Pen-Ek Ratanaruang (Silence). Il est toujours agréable de terminer par un film sortant un peu de l’ordinaire, qui plus est réalisé par des têtes à présent bien connues des amateurs de cinéma asiatique, qui exposent par le biais de la fiction leur vision de la Cité des Anges. J’avoue honteusement ne connaître Wisit Sasanatieng que par ses deux premiers films. Découvrir l’une de ses dernières réalisations avait donc quelque chose d’excitant, au même titre que celle de Pen-Ek, pour le fan boy que je suis. Wisit, donc, et sa jeune femme aveugle vendant des tickets de loterie sous le pont où elle crèche, tout en écoutant ses morceaux de musique favoris, rare moyen d’évasion. C’est avec l’apparition miraculeuse d’un ange bien désireux de lui faire découvrir la vie autour d’elle qu’elle va échapper à son quotidien bien morne. Presque virtuose mais bien cinglé, Sightseeing mêle imaginaire et fiction en forme de brouillon de l’œuvre de Wisit. Pas mémorable mais suffisamment flottant pour intéresser. Bangkok Blues de Aditya Assarat (connu chez nous pour son étrange Wonderful Town) continue la lancée mais n’aura pas réussi à capter mon attention. Endormi presque tout du long, il me reste quelques bribes d’une mise en scène assez pauvre et de bruitages « faisant sens », contrastant drôlement avec le lieu désert et particulièrement silencieux. Le concept est intéressant puisque les bruitages que l’on entend proviennent des enregistrements du jeune preneur de son, en discussion tout du long avec une jeune femme. Troisième segment réalisé par Kongdej Jaturanrasamee (encore inconnu en France), Pi Makham nous amène au parc Sanam Luang, où un jeune provinciaux souhaite passer la soirée avec une prostituée. Ravissante et mystérieuse, la jeune femme imbibée de mélancolie va s’avérer être plus qu’un simple être de chair. Joliment filmée, cette balade nocturne aux relents surnaturels se clôt hélas par un twist tiré par les cheveux et pas vraiment utile. On n’allait tout de même pas terminer sur une note négative, le Silence de Pen-Ek arrive alors à point nommé. La preuve qu’un cinéaste armé d’un pitch incroyablement simple (en rentrant chez elle en voiture à 2h du matin, une jeune femme branchée tombe en panne avant qu’un inquiétant clochard sourd et muet n’apparaisse au milieu de nulle part) peut exprimer toute une palette de sensations : agacement, crainte, effroi, empathie. Entre thriller d’épouvante et expérience humaniste, Pen-Ek signe une petite réussite décalée et touchante. Enfin, celles et ceux qui seront restés jusqu’au générique de fin (une obligation au C.I.D !) ont pu se délecter d’une hilarante chanson mettant en scène tous les principaux acteurs du projet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que note ami Pen-Ek s’est carrément lâché.


Déjà d’excellents souvenirs que cette 12ème édition du Festival du film asiatique de Deauville. Hormis de sacrées surprises (City of Life and Death, Cast Away on the Moon, Au Revoir Taipei, Paju, Nuits d’ivresse printanière) et d’autres moins triomphales (My Daughter, The Eternal, The King of Jail Breakers), les excellents moments passés en compagnie de mes camarades d’un temps (cinemasiens, bloggeurs) auront donné encore plus de saveur au festival, dont la sélection au départ guère enthousiaste aura finalement livrée de sacrées réussites cinématographiques. Les mauvaises langues campant sur leurs positions devraient venir faire un tour ici un peu plus souvent plutôt que de se braquer sur la 11ème édition qui, semble t-il, n’aura convaincu à peu près personne. Et si face aux médias internet spécialisés, Libération ou 20 Minutes auront toujours le tapis rouge pour les interviews (malgré leurs papiers de 3 lignes sur tel ou tel réalisateur/acteur), donnant ainsi toute sa saveur aux éternelles « dix minutes d’interview, pas plus », l’évènement fut une réussite malgré le peu de présentations post-projections au C.I.D. Avec une chute des sponsors et des chiffres de fréquentation tronqués (parait-il que 19 000 festivaliers étaient présents cette année, la blague), on espère que Deauville restera tout de même l’une des villes de France à accueillir un évènement comme celui-ci.
